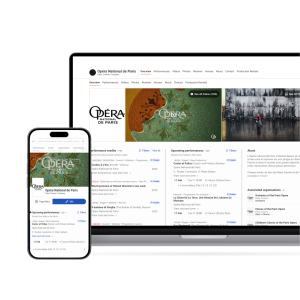Le 27 février dernier, la merveilleuse soprano italienne, inoubliable Mimi, Adina et Susanna, a soufflé ses 80 bougies. Deux jours plus tôt, la Scala de Milan, sans doute le théâtre auquel son nom reste le plus attaché, lui consacrait une soirée spéciale, marquée par un entretien à bâtons rompus avec les critiques musicaux Elvio Giudici et Alberto Mattioli. Accueillie par une « standing ovation » de la part d’un public nombreux, l’artiste, après les mots de bienvenue d’Alexander Pereira et Riccardo Chailly, respectivement surintendant et directeur musical de la maison, a ouvert son album de souvenirs. L’occasion de vérifier qu’elle n’a pas été surnommée « la prudentissima » pour rien… Soprano lirico leggero à ses débuts, à l’âge de 20 ans, Mirella Freni a su respecter l’évolution naturelle de sa voix pour progressivement s’orienter, en un demi-siècle de carrière, vers des emplois plus lourds, jusqu’au lirico spinto d’Aida, Manon Lescaut et Adriana Lecouvreur.

Bienvenue sur ce plateau, où vous avez participé à tant de spectacles inscrits en lettres d’or dans l’histoire de la Scala…
Je suis si émue… C’est ma maison ici, vous savez. Laissez-moi le temps de reprendre mon souffle, sinon je vais commencer à raconter des bêtises ! J’ai des souvenirs merveilleux dans ce théâtre – « Nous aussi ! » crie un spectateur –, des souvenirs de spectacles, de rencontres, de collaborations avec d’immenses artistes. En plus de Nicolai Ghiaurov, qui a partagé ma vie pendant de longues années (1), je me souviens avec plaisir d’autres chanteurs aujourd’hui disparus, tels Piero Cappuccilli ou Gianni Raimondi. Nous travaillions tellement bien ensemble… et ils n’ont jamais été remplacés.
Sept jours après vos débuts à la Scala, le 9 janvier 1962, en Nannetta dans Falstaff, en remplacement de Renata Scotto souffrante, on vous retrouve à la Piccola Scala, pour Romilda dans Serse de Haendel. Mais c’est l’année suivante, dans cette fameuse nouvelle production de La Bohème, dirigée par Herbert von Karajan et mise en scène par Franco Zeffirelli, que vous obtenez votre premier grand succès. Comment votre rencontre avec le maestro s’est-elle passée ?
J’étais plus mince qu’aujourd’hui, et c’était important pour Karajan, qui tenait beaucoup à la crédibilité scénique des personnages ! N’étant pas sûre d’avoir le physique de Mimi, j’étais bien décidée à me concentrer sur le chant. Au début de l’audition, le maestro s’est mis au piano et j’ai attendu qu’il me demande d’entonner « Si, mi chiamano Mimi ». À ma grande surprise, il s’est mis à faire défiler les pages de la partition jusqu’au quatrième acte et, soudain, j’ai compris : il voulait s’assurer que j’étais une artiste, et pas simplement une bonne chanteuse. Au bout de quelques minutes, il s’est arrêté, s’est levé, et m’a dit : « OK, on y va ! » – « Où ? » ai-je répondu – « On commence les répétitions ! » Par la suite, j’ai vécu sous sa baguette des moments inoubliables, comme mon premier Requiem de Verdi. Je comprenais ce qu’il voulait sans même le regarder…
Le 7 décembre 1963, vous ouvrez pour la première fois la saison de la Scala, en Suzel dans L’amico Fritz. Puis vient cette soirée tristement célèbre du 17 décembre 1964, marquant vos débuts en Violetta dans La traviata, avec les mêmes Karajan et Zeffirelli aux commandes. Une soirée émaillée de sifflets, de cris, d’interjections diverses et variées, y compris pendant que vous chantiez… La seule fois dans votre carrière où vous avez été contestée par le public, de manière parfaitement injuste d’ailleurs !
Pourquoi voulez-vous reparler de cette soirée ? Je ne me souviens plus de rien ! Non, c’est faux, je me rappelle beaucoup de choses… Les jours précédant la première, j’avais reçu des lettres anonymes, des menaces. Milan ne parlait que de cette Traviata, des tempi choisis par Karajan… Clairement, une cabale se préparait. À la fin de la représentation, j’étais évidemment triste, mais également dans une colère noire. Je suis revenue saluer, les mains sur les hanches, comme pour dire à ces gens : « Allez-y, sifflez-moi, je suis là, devant vous ! » Puis Luciano Pavarotti, qui était dans la salle, m’a rejointe et m’a ramenée à Modène. Avec Luciano, nous étions comme frère et sœur : nés la même année, dans la même ville, nous avons grandi ensemble… Ce soir-là, le public était venu pour me tuer ; comme vous le voyez, cinquante ans plus tard, je suis encore là !
-
Lire la suite dans Opéra Magazine numéro 105