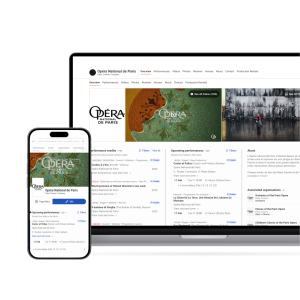Disparu en 2004, le baryton, passé à la postérité avant tout comme un spécialiste de la mélodie et du lied, aurait fêté ses 100 ans, le 8 décembre. L’occasion d’évoquer le souvenir de l’un des plus formidables ambassadeurs du chant français au XXe siècle, plus souvent reconnu à l’étranger que dans son propre pays. Admirablement servi par les firmes de disques de son vivant, de Decca à Denon, en passant par EMI, Philips, RCA ou Deutsche Grammophon, Gérard Souzay n’a intéressé personne en cette année de centenaire, alors que d’autres artistes de sa génération se sont vu offrir de somptueux coffrets d’hommage. Serait-il encore victime, à soixante ans de distance, de l’anathème « bourgeois » jeté contre lui par Roland Barthes ?
Alors jeune ténor, Gérard Souzay, pseudonyme de Gérard Tisserand, fait ses études au Conservatoire de Paris, dès 1940, avec la mezzo-soprano Claire Croiza et le baryton-basse Vanni Marcoux, sur les conseils du baryton Pierre Bernac, ami et interprète favori de Francis Poulenc. La conjonction de ces trois maîtres-chanteurs est comme une manière de nombre d’or du chant français de l’époque, sous sa double espèce, mélodie et opéra. Dans les années 1950-1960, à l’été de sa voix, Souzay réconcilie ces frères ennemis que sont alors, si souvent, le lyrisme opératique et ce que les tenants de la mélodie française nomment, à la suite de Ronsard, le « bien dire une mélodie». La célèbre Croiza vient de l’opéra, mais elle a fait sienne la religion de ce « bien dire » pour devenir l’interprète d’élection de Ravel, Debussy et de tant d’autres. Une artiste qui, de Poulenc, se fera apprécier, en amont de Bernac précisément.
Dans ce cercle de récitalistes, on est porté à excommunier les grandes voix qui, de la mélodie française, tendent à exacerber la seule volupté sonore, au détriment de la prononciation et de l’articulation, mises au service de l’expression du fruit poétique dont il s’agit de recueillir la moindre goutte. La même éthique vaut pour le lied, ce dernier demeurant alors une forme littéraire poétique avant que de se couler dans la musique portée par le chant. Souzay partagera cette approche avec la grande Lotte Lehmann, éduquée à l’opéra comme à Schubert ou Schumann. « Pour l’entendre, je ferais un long voyage » dira de lui, bientôt, cette dernière.
C’est instruit de ces deux philosophies vocales que Gérard Souzay, élevé au sein de l’art mélodique, abordera la scène lyrique, avec un éventail réduit de rôles, d’où se détachent Golaud dans Pelléas et Mélisande, le Comte Almaviva dans Le nozze di Figaro et, surtout, Don Giovanni. Certaines inflexions, un rien trop hexagonales, et le sfumato ostensible du phrasé peuvent surprendre à l’écoute de ces Mozart, aux antipodes du baroquisme qui prévaut aujourd’hui. Le jeune Souzay y faisait néanmoins valoir une santé vocale propre à l’absoudre de ses péchés stylistiques.
Reste qu’accompagné par le superlatif pianiste américain Dalton Baldwin, le récitaliste finira bientôt par éclipser le chanteur d’opéra, à mesure qu’il se produira avec grand succcès en Europe, mais aussi en URSS, au Japon, en Australie et en Amérique, dans son répertoire d’élection : la mélodie, française ou étrangère. L’éloquence du mot passerait-elle in fine la promesse du timbre ? Grâce à Henri-Bertrand Etcheverry, Golaud dans la mythique intégrale de Pelléas et Mélisande dirigée par Roger Désormière (EMI/Warner Classics), qui l’a converti à la voix de baryton, Souzay marie, en tout cas, magie des mots et vocalité prégnante en de fécondes noces de l’esprit et des sens.
De ce point de vue, la querelle byzantine que lui cherchera Roland Barthes, dans ses Mythologies (Éditions du Seuil, 1957), à l’orée d’une carrière de récitaliste appelée à se développer durant plus d’un demi-siècle, est ridicule (1). D’abord parce qu’il ne s’agit pas de savoir si l’art de Souzay est bourgeois, au sens péjoratif du mot, ce qui n’a pas grand sens s’agissant de l’interprétation de Fauré, si peu libertaire et prolétarien. Ensuite parce que tout l’art de Souzay réside dans la fusion du vers et de son enveloppe sonore, du signe et du signifié (pour parler le Barthes dans le texte), du dire et de l’indicible.
Le jardin secret du chanteur réside, quoi qu’il en soit, dans ses gravures des années 1950, témoins de la beauté juvénile du timbre, comme de la fluidité d’un phrasé que n’altère en rien le soin de l’élocution. Ainsi du bouquet d’airs français revisités en 1953, avec la pianiste ailée Jacqueline Bonneau (regroupés en CD par Testament sous le titre Baroque, Classical & Traditional Songs & Arias), qui, partant de ceux de la cour d’Henri IV et du rare Tu crois ô beau soleil de Louis XIII, invite l’auditeur à découvrir maîtres et petits maîtres d’Italie et d’Allemagne, et notamment un déchirant Miserere de Peri, avant de précieux Scarlatti. L’opéra ancien s’invite en écho dans ce disque, le baryton se montrant tout aussi éloquent et ductile dans des pages choisies de Lully et Rameau, qu’il reprendra plus tard avec Raymond Leppard ou Nikolaus Harnoncourt.
Lire la suite dans Opéra Magazine numéro 145