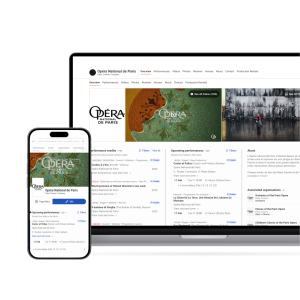Le bicentenaire de sa naissance, le 28 janvier 1814, est passé un peu inaperçu. La créatrice de Rachel dans La Juive, puis de Valentine dans Les Huguenots, disparue en 1897, a pourtant joué un rôle déterminant dans l’histoire de l’opéra, au point de donner son nom à une catégorie vocale encore usitée aujourd’hui, à mi-chemin entre soprano et mezzo.
 Au moment de déposer une rose aux pieds de la Vierge de marbre veillant sur la tombe de Marie-Cornélie Falcon, il nous semble entendre monter des allées du Père-Lachaise (55e division) le « Pietà, Signore » chanté par Fernando De Lucia aux obsèques d’Enrico Caruso, en 1921. La célèbre prière, bien que d’attribution douteuse, est, on le sait, ce qui demeure à jamais de l’opéra Stradella de Louis Niedermeyer (1802-1861), consacré au sulfureux compositeur romain du XVIIe siècle, jadis assassiné pour avoir enlevé la protégée d’un noble vénitien. Or, c’est au cœur de la deuxième représentation dudit opéra, le lundi 6 mars 1837, à l’Académie Royale de Musique, que la voix de Falcon connut la première brisure tragique dont elle ne devait jamais se remettre. À l’invitation du héros éponyme, incarné par le ténor Adolphe Nourrit (« Demain nous partirons, voulez-vous ? »), la jeune femme de 23 ans (!), soudain oppressée, fut incapable de répliquer par son « Je suis prête », si peu en situation alors qu’elle allait s’évanouir en scène.
Au moment de déposer une rose aux pieds de la Vierge de marbre veillant sur la tombe de Marie-Cornélie Falcon, il nous semble entendre monter des allées du Père-Lachaise (55e division) le « Pietà, Signore » chanté par Fernando De Lucia aux obsèques d’Enrico Caruso, en 1921. La célèbre prière, bien que d’attribution douteuse, est, on le sait, ce qui demeure à jamais de l’opéra Stradella de Louis Niedermeyer (1802-1861), consacré au sulfureux compositeur romain du XVIIe siècle, jadis assassiné pour avoir enlevé la protégée d’un noble vénitien. Or, c’est au cœur de la deuxième représentation dudit opéra, le lundi 6 mars 1837, à l’Académie Royale de Musique, que la voix de Falcon connut la première brisure tragique dont elle ne devait jamais se remettre. À l’invitation du héros éponyme, incarné par le ténor Adolphe Nourrit (« Demain nous partirons, voulez-vous ? »), la jeune femme de 23 ans (!), soudain oppressée, fut incapable de répliquer par son « Je suis prête », si peu en situation alors qu’elle allait s’évanouir en scène.
Berlioz, qui l’admirait – sans avoir cautionné toutefois ses Donna Anna de 1834 –, évoqua ce soir funeste de 1837, sa voix offusquée, ses sonorités de flûte remplie d’eau et sa gutturalité semblable à celle d’un enfant atteint du croup ! Les mois qui suivirent confirmèrent la dégradation vocale de l’artiste, obligée de suspendre sa fulgurante carrière après la représentation des Huguenots du 15 janvier 1838, moins de six ans après ses débuts à l’Opéra, en Alice de Robert le Diable (20 juillet 1832), à l’âge de 18 ans. Théophile Gautier raconta à son tour, dans Le Figaro, comment « ce charmant rossignol » ayant perdu la voix, « une grave assemblée de docteurs » jugea le voyage en Italie indispensable. À Naples, plus précisément, là « où Mmes Catalani et Pasta se réfugiaient quand les brouillards de Londres et l’influenza de Paris avaient altéré leur fa ou leur la ».
Voyage de la dernière chance pour Cornélie Falcon, puisque la voix ne semblait plus alors répondre que dans la première partie de la journée, pour s’étioler à partir de cinq heures de l’après-midi. Las ! L’air tiède et balsamique de ce mélodieux pays n’opéra point le miracle espéré. Alors que Donizetti pensait encore pouvoir lui confier, en 1840, la Pauline de ses Martyrs, un retour sur la scène de l’Académie Royale de Musique pour un gala, le 14 mars de cette même année, s’avéra catastrophique. Accueillie triomphalement, la jeune étoile (elle n’avait que 26 ans !), confrontée aux extraits du deuxième acte de La Juive et, surtout, à ceux des Huguenots, pour elle emblématiques, trahit d’irréparables failles. Cruauté du sort, le duo du IV avec Raoul, avec ses déchirants « Il n’est plus d’avenir !… Nuit funeste ! », provoqua le raptus fatal.
QUELLE VOIX ?
Foudroyée, la tragédienne-née entre bientôt dans la légende. Son nom immortalise, comme à son corps défendant, un type de voix féminine singulier. Cornélie ne chante plus mais le falcon demeure, encore aujourd’hui, un profil vocal, plus ou moins bien défini, de soprano dramatique à l’ancienne, aux graves corsés et à l’aigu fragile. En France d’abord, où il est habituel que telle ou telle typologie hérite du nom d’un artiste célèbre, de la Dugazon à son élève Jean-Blaise Martin, modèle du baryton homonyme, jusqu’au comique d’opérette empruntant son patronyme au chanteur de composition du XVIIIe siècle, Antoine Trial. Dans le répertoire étranger ensuite, le terme de falcon s’appliquant, de manière plus ou moins aléatoire, à des interprètes d’Élisabeth de Valois dans le Don Carlos verdien comme à celles de Vénus ou d’Élisabeth dans le Tannhäuser wagnérien.
Avant de faire la part de la tradition et celle de l’à-peu-près dans cette survivance d’un nom ainsi passé à la postérité pour ses failles autant que pour ses mérites, il importe de cerner les traits essentiels de cette voix mythique. La tâche n’est point aisée. Faut-il, par exemple, considérer comme significatif le fait que la jeune Cornélie, en 1835, ait pu se produire à l’Opéra de Paris et séduire un public d’élites en Pamyra du Siège de Corinthe, rôle créé in loco, neuf ans plus tôt, par Laure Cinti-Damoreau, rossinienne bon teint et soprano candide ? Le très expert Rodolfo Celletti (1917-2004) nous met en garde contre toute tentation d’assimilation entre ces deux artistes de légende.
Sur le plan intrinsèquement vocal, il pointe une différence capitale entre Cinti-Damoreau, chez elle dans les tessitures aiguës et la vocalisation aérienne, et Falcon. « Au zénith de sa brève carrière, écrit-il, Cornélie couvrait plus de deux octaves, du si grave au contre-ré, mais il ne faut pas pour autant en déduire qu’elle pouvait aborder les tessitures de la Damoreau ou qu’elle trouvât dans le chant virtuose son terrain de prédilection. » En vérité, la présence de la jeune artiste à l’affiche de ce Siège rossinien, dans un emploi qu’une Beverly Sills surchargera à notre époque de ses extrapolations au-dessus de la portée, cette présence doit beaucoup au fait qu’Adolphe Nourrit, son partenaire mais surtout son professeur, l’avait enrôlée pour la circonstance. Et Celletti de nous rappeler qu’à en juger d’après Rachel de La Juive et Valentine des Huguenots, deux rôles expressément conçus à son intention, respectivement en 1835 et 1836, la voix de l’ardente Cornélie est le plus souvent sollicitée dans le médium et le grave, malgré quelques échappées au contre-ut, alors que la déclamation est véhémente, particulièrement sur le fa, le sol et le la aigu, sans vocalise, en détachant les syllabes.