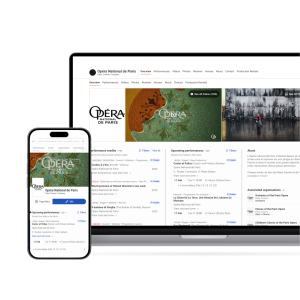L’illustre basse d’origine bulgare aurait eu 100 ans, le 18 mai. Né en 1914, mort en 1993, Boris Christoff a durablement marqué la mémoire des mélomanes dans des rôles auxquels sa voix et sa personnalité restent indissolublement liées, comme Boris Godounov, Filippo II, Padre Guardiano ou Méphistophélès. Occupant, dans l’univers de la mélodie russe, un statut équivalent à celui de Hans Hotter ou Dietrich Fischer-Dieskau dans le lied allemand, prolongeant le mythe Chaliapine aux yeux et aux oreilles de l’Occident, il a également été un exemple pour de nombreux chanteurs de l’ancien bloc de l’Est.
 De sa Bulgarie natale, Boris Christoff avait hérité les harmoniques slaves de son timbre. Au sein des chœurs de la cathédrale Alexandre-Nevski et de la Chapelle royale de Sofia, il avait bénéficié de la discipline inculquée dans ces ensembles de haut rang. Restait à façonner ce métal brut et à développer ces acquis musicaux au service d’une carrière dédiée à l’opéra et au récital.
De sa Bulgarie natale, Boris Christoff avait hérité les harmoniques slaves de son timbre. Au sein des chœurs de la cathédrale Alexandre-Nevski et de la Chapelle royale de Sofia, il avait bénéficié de la discipline inculquée dans ces ensembles de haut rang. Restait à façonner ce métal brut et à développer ces acquis musicaux au service d’une carrière dédiée à l’opéra et au récital.
L’ÂME SLAVE ET L’ARCHET ITALIEN
Quiconque écoute aujourd’hui un enregistrement de cet artiste superlatif, au meilleur de lui-même dans les opéras et les mélodies de Moussorgski aussi bien que dans Verdi ou certains Wagner, est immédiatement frappé par l’intime fusion d’une couleur profuse et profonde, concentrée sur le poids émotionnel du mot, et d’un phrasé souverain, coulant ces mots dans un legato d’instrument à cordes. Cet art du chant, déployé quarante ans durant dans les répertoires et les idiomes les plus divers, le chanteur l’avait assimilé en Italie, auprès des meilleurs. Qu’on en juge : arrivé à Rome, en 1942, le jeune homme auditionne devant les ténors Aureliano Pertile et Beniamino Gigli, puis devant le baryton Giuseppe De Luca, pour aussitôt se retrouver élève du verdianissime Riccardo Stracciari !
Interrompues par la guerre, qui lui vaut d’être interné dans un camp du Tyrol, ses études reprennent trois ans plus tard avec ce dernier. On hésite un moment sur la tessiture de cet élève exceptionnel : baryton ? basse ? En vérité les deux. Le confirme le concert que l’Académie Sainte-Cécile de Rome lui propose, le 28 décembre 1945, où Leporello côtoie Boris Godounov. L’Italie, dont il sillonne bientôt les routes avec une compagnie itinérante, fait sien ce chanteur éclectique. 1947 le voit endosser la bure du moine Pimène à l’Opéra de Rome, puis à la Scala de Milan, au côté du Boris de l’immense Tancredi Pasero. Remplaçant ce dernier l’année suivante, il se coiffe de la couronne du tsar à Cagliari, l’opéra de Moussorgski devenant aussitôt l’un de ses ouvrages phares. Ses attributs purement vocaux l’autorisent, en outre, à briller dans Tristan und Isolde, Lohengrin, Tannhäuser et L’incoronazione di Poppea aussi bien que dans I puritani (face à la jeune Maria Callas, en 1949 à Venise), parmi une multitude d’autres emplois.
DE LA VOIX ET DU GESTE
Boris Godounov cristallise le meilleur de cet éclectisme. Inscrit dans la culture du Slave, et malgré ses consonances russes si spécifiques, l’ouvrage lui permet de faire valoir une extraordinaire présence scénique, souvent rapprochée de celle du mythique Fiodor Chaliapine (1873-1938). On suggèrera que le cliché du « chanteur-acteur » n’a ici de sens que rapporté au primat du chant et de l’ego de l’artiste sur les prérogatives du metteur en scène. Quand, en 1949, Boris Christoff met le Covent Garden à ses pieds, c’est précisément en invoquant les spectacles dudit Chaliapine, mis en scène par le célèbre Alexandre Sanine, pour contrer les options de Peter Brook, à ses yeux fantaisistes.
Pendant quelque trente ans, Londres chérira cette interprétation pouchkinienne. Deux intégrales de studio l’ont préservée. Dans celle de 1952, dirigée par Issay Dobrowen, Christoff cumule le rôle-titre (hyperbolique), Pimène (énoncé à mi-voix) et le truculent Varlaam, exploit réédité avec moins d’assurance dix ans plus tard, sous la baguette d’André Cluytens. À l’Opéra de Paris, en 1953, notre tsar avait pu s’en remettre à la régie du suprême Vanni Marcoux, autre titulaire émérite du rôle, pour faire valoir sa propre vision du personnage. Une égale empathie vocale et expressive marquait ses incarnations d’Ivan Soussanine dans Une vie pour le Tsar, pathétique et noble, du jouisseur Galitski et du guerrier Kontchak dans Le Prince Igor, tous deux magnifiquement phrasés et déclamés.