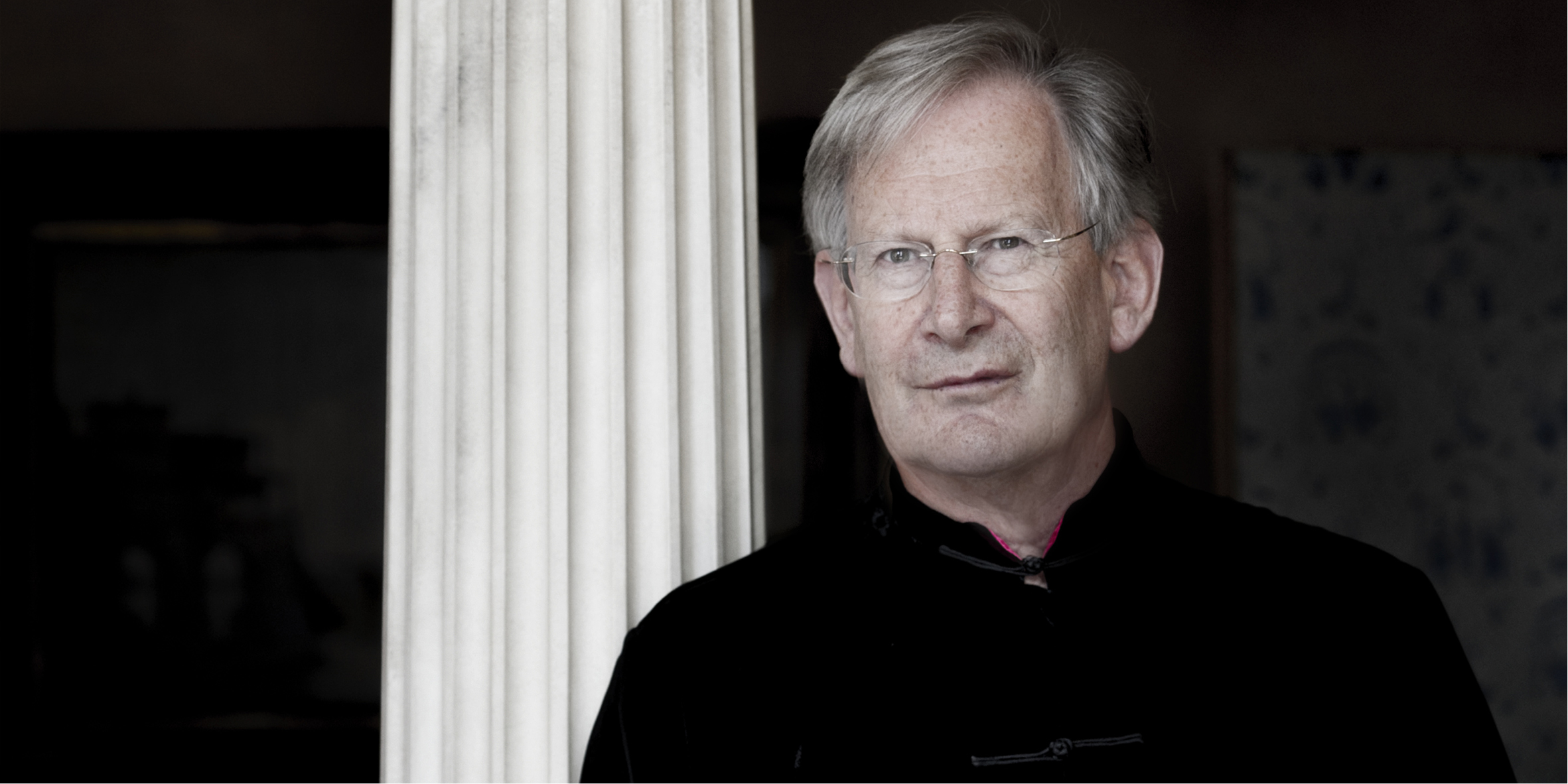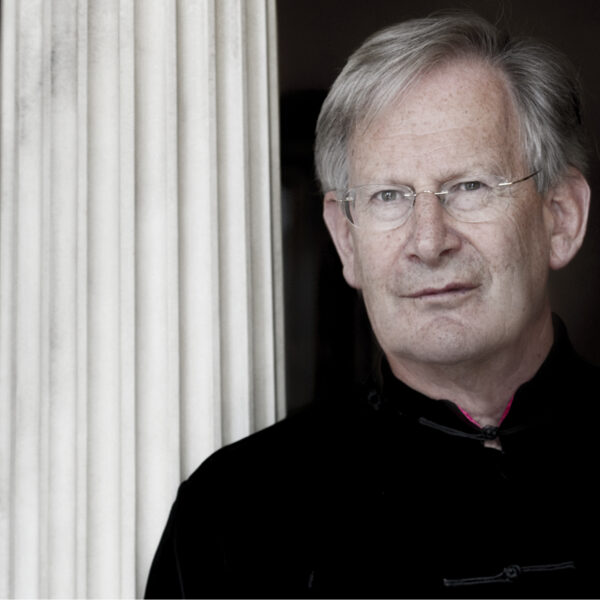Opéra Royal, 8 septembre
En 2002, John Eliot Gardiner abordait Benvenuto Cellini à Zurich. Dix-sept ans plus tard, il revient au même ouvrage à la faveur d’une tournée qui, partie de La Côte-Saint-André, l’a emmené à la Philharmonie de Berlin, puis aux Proms de Londres, avant une ultime représentation à l’Opéra Royal de Versailles.
Car il s’agit là d’autre chose qu’une simple mise en espace, réglée par Noa Naamat : les chanteurs sont costumés, les lumières travaillées, et à défaut d’un décor, un praticable destiné aux chœurs, derrière l’orchestre, permet également aux solistes de ne pas se confiner à l’avant-scène. Grâce à l’enthousiasme du Monteverdi Choir, toujours aussi rigoureusement préparé et prêt à toutes les fantaisies, ce type de conception produit une réelle animation et vaut toutes les mises en scène. On regrette simplement que l’épisode du concours de chant soit, ici comme ailleurs, aussi confus, avec un ophicléide traité comme un personnage et un cor anglais qui reste perdu dans l’orchestre.
Gardiner connaît Berlioz sur le bout de ses doigts. Ses choix sont, en grande partie, les mêmes qu’en 2002 : il opte pour la version dite « Paris 1 », sans l’air de Balducci (« Ne regardez jamais la lune »), ni la « Romance » de Cellini au deuxième tableau (dommage, quand on a un Michael Spyres sous la main !), mais avec l’air d’Ascanio (« Mais qu’ai-je donc ? »).
Il choisit, cette fois, la seconde mouture de l’air de Teresa (« Entre l’amour et le devoir »), tout en persistant dans cette idée déconcertante qui consiste, au dernier tableau, à faire intervenir l’air « Sur les monts » après la provocation en duel de Fieramosca, en confiant les interventions solistes du chœur « Bienheureux les matelots » non pas à Cellini et Ascanio, mais à Francesco et Bernardino.
On l’a compris : même s’il s’agit là de choix qui n’appartiennent qu’à lui, Gardiner a réfléchi à la partition ; on est ici à cent lieues du Benvenuto Cellini bâclé qu’avait signé Philippe Jordan à l’Opéra Bastille, en mars 2018 (voir O. M. n° 139 p. 66 de mai). Sur le plan musical également, c’est tout autre chose : dès l’Ouverture, jouée par les musiciens debout, tout n’est que feu, mouvement, éclat, grâce aux couleurs crues de l’Orchestre Révolutionnaire et Romantique, mises en valeur par l’acoustique de l’Opéra Royal.
La distribution est dominée par Michael Spyres, le seul ténor du moment qui puisse chanter Faust, Énée, Cellini (mais aussi Lélio ou le Sanctus du Requiem) avec la même aisance. Mieux, de production en production, Michael Spyres se familiarise avec la langue française, soigne les nuances et les détails, et joue de mieux en mieux. Le style est presque idéal, avec un bonheur dans le dessin de la ligne, et des aigus tantôt en voix de tête, tantôt, quand il le faut, en voix de poitrine (hommage à Duprez, le créateur du rôle !), sans qu’ils soient jamais criés.
Le duo avec Teresa, au troisième tableau, laisse entrevoir quelques signes de fatigue, de même que la toute fin de l’air « Sur les monts », abordé avec la simplicité qui convient, puis un lyrisme qui va croissant et se marie dans l’ivresse avec les instruments. Mais la scène de la fonte (laquelle fait apparaître, en statue de Persée, le comédien Duncan Meadows, qu’on voit souvent déguisé en Pharaon doré devant le British Museum !) permet au ténor américain de retrouver toutes ses forces.
Maurizio Muraro est bien plus audible qu’à l’Opéra Bastille, où il était déjà Balducci ; Lionel Lhote, en Fieramosca, joue avec brio la carte du comique, sans oublier de chanter ; Sophia Burgos manque d’un peu de piquant, mais l’intelligence de ses vocalises et un lyrisme qui n’est jamais affecté en font une Teresa séduisante.
On a cité la dimension en partie comique de la soirée, qui profite à l’excellent Cabaretier de Peter Davoren, mais le Clément VII de Tareq Nazmi en pâtit : bâillements volontaires, petits pas de danse, voilà un Pape dont la dignité vocale est contredite par une composition caricaturale. Reste Adèle Charvet, qu’on entend malheureusement de trop loin dans le premier air d’Ascanio, chanté sur le praticable, mais qui offre un « Mais qu’ai-je donc ? » plein d’aplomb.
Voilà une jeune interprète qu’on aimera retrouver et qui nous rappelle qu’il est possible, aujourd’hui, de réunir une distribution convaincante pour chanter Benvenuto Cellini – à condition qu’il y ait un chef prêt à défendre cette partition, qui laisse étourdi par la prodigalité de son inspiration.
CHRISTIAN WASSELIN
PHOTO © DR