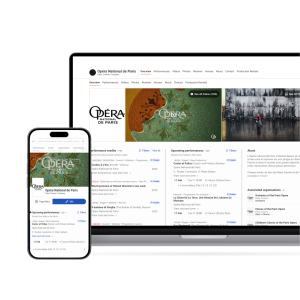« Panthère », « tigresse »… les journalistes ont régulièrement filé la métaphore féline pour décrire Grace Bumbry, qui vient de disparaître, le 7 mai, à Vienne, à l’âge de 86 ans. Classée parmi les mezzo-sopranos, parce que c’est dans ce registre qu’elle était devenue mondialement célèbre, et qu’elle a laissé ses enregistrements les plus mémorables, elle se revendiqua explicitement soprano pendant plus d’un demi-siècle. À l’instar de Shirley Verrett, son aînée de six ans, avec laquelle elle partageait de nombreux points communs, elle incarnait en réalité, pour beaucoup d’historiens du chant, l’idéal du « falcon », ce « soprano-mezzo » dont Meyerbeer, Verdi et Wagner firent un large usage.
Née le 4 janvier 1937, à Saint-Louis (Missouri), Grace Bumbry y commence ses études de chant. En 1955, elle part en Californie, pour se perfectionner avec Lotte Lehmann. Alors que son précédent professeur la voyait plutôt soprano, la légendaire cantatrice allemande naturalisée américaine, créatrice de plusieurs opéras de Richard Strauss, lui dit qu’elle est mezzo et la fait donc travailler dans cette tessiture. Au bout de quatre ans, c’est le départ pour l’Europe. Comme Marilyn Horne juste avant elle, la jeune chanteuse estime que les États-Unis ne lui offrent pas suffisamment de possibilités de faire carrière, les théâtres de renom étant à l’époque très peu nombreux.

© The Metropolitan Opera Archives / Erika Davidson
Grace Bumbry obtient donc un contrat dans la troupe de l’Opéra de Bâle. Mais c’est à l’Opéra de Paris qu’elle fait ses débuts scéniques, en Amneris dans Aida, en 1960. Un triomphe ! Peu après, elle auditionne devant Wieland Wagner, qui recherche désespérément une Venus pour sa nouvelle production de Tannhäuser au Festival de Bayreuth. La chance veut qu’elle soit exactement l’incarnation du mélange d’érotisme et de réserve qu’il ne trouve pas chez les titulaires du rôle de sa connaissance. Aussitôt engagée, elle fait son entrée au Festspielhaus à l’été 1961, non sans soulever de vives polémiques.
Aucun artiste de couleur, en effet, ne s’est jamais produit sur la « Colline verte ». Les courriers affluent donc sur le bureau de Wieland Wagner, telle cette lettre anonyme reproduite dans le livre de Pierre Flinois sur le Festival de Bayreuth (Éditions Sand) : « Monsieur. Bien sûr, je n’ai pas de préjugés contre les Noirs ! Mais permettez-moi de vous dire que vous avez fait preuve d’un grand manque de tact envers les admirateurs de Wagner et, en même temps, d’un mauvais goût absolu, en permettant à une chanteuse noire de se produire sous ces « voûtes sacrées » et, de plus, sur une scène d’opéra allemande. »
Wieland Wagner, bien évidemment, n’en tient aucun compte, réinvitant immédiatement sa « Vénus noire » pour l’édition 1962 du Festival. Quant à Grace Bumbry, qui en a vu d’autres dans son pays natal pendant son enfance et son adolescence, elle poursuit son ascension, l’une des plus fulgurantes dans toute l’histoire de l’opéra au XXe siècle : débuts au Covent Garden de Londres, en 1963 (Eboli dans Don Carlo), au Staatsoper de Vienne (Eboli encore) et au Festival de Salzbourg (Lady Macbeth dans l’opéra de Verdi), en 1964, au Metropolitan Opera de New York (Eboli toujours), en 1965, à la Scala de Milan (Amneris), en 1966.
À la même époque, Grace Bumbry déploie une intense activité dans les studios d’enregistrement, léguant d’électrisantes Eboli et Amneris dans les intégrales de Don Carlo (Decca) et Aida (EMI/Warner Classics), respectivement dirigées par Georg Solti et Zubin Mehta. Avec les captations sur le vif du Tannhäuser de Bayreuth (Philips) et du Macbeth de Salzbourg (Orfeo), ainsi que les différents récitals d’airs d’opéras et de lieder gravés pour Deutsche Grammophon et EMI/Warner Classics, ces témoignages permettent de se faire une idée exacte de cette voix longue, homogène, à la couleur moins métallique que celle de Shirley Verrett, à l’aigu facile et percutant, au grave parfaitement naturel. Atouts auxquels s’ajoutent un tempérament de feu et des accents « félins » parfaitement en situation dans les rôles énumérés plus haut.

En 1966, Herbert von Karajan lui confie Carmen, dans une nouvelle production au Festival de Salzbourg, filmée en studio l’année suivante (en DVD chez Deutsche Grammophon). Elle ne s’entend pas avec lui mais le film permet au moins, par rapport au disque audio (EMI/Warner Classics, avec Rafael Frühbeck de Burgos au pupitre), de prendre la mesure de la beauté et de la sensualité de l’actrice. Carmen, malheureusement, à l’instar d’Ulrica dans Un ballo in maschera, Azucena dans Il trovatore et Dalila dans Samson et Dalila, qu’elle reprend régulièrement en ces années 1960, est un rôle dans lequel Grace Bumbry se sent de plus en plus fatiguée vocalement. Consultés, des médecins lui expliquent qu’elle chante des tessitures trop graves pour elle et lui conseillent de se tourner vers des emplois de vrai soprano.
Elle ne se le fait pas dire deux fois et, dès 1970, aborde la Salome de Richard Strauss, au Covent Garden. Ensuite, elle n’arrête plus, dans des univers musicaux extrêmement contrastés : Tosca, Jenufa, Ariane dans Ariane et Barbe-Bleue de Dukas, Norma, Bess dans Porgy and Bess, Leonora dans Il trovatore et La forza del destino, Elvira d’Ernani… jusqu’à Abigaille dans Nabucco et Turandot, qui ont mis à rude épreuve les plus fameuses sopranos dramatiques du XXe siècle.
Grace Bumbry ne renonce pas pour autant aux emplois de mezzo-sopranos les plus aigus de son répertoire, ceux que l’on range sous l’étiquette « falcon », tels Eboli et Amneris (entre autres pour ses débuts aux Chorégies d’Orange, en 1976). Mais, dans Aida, elle prend plaisir à alterner la princesse égyptienne avec le rôle-titre, de même que, dans Tannhäuser, elle enchaîne Venus et Elisabeth. « Falcons » encore, Sélika dans L’Africaine de Meyerbeer, Chimène dans Le Cid de Massenet (en CD chez Sony Classical), Cassandre et Didon dans Les Troyens (qu’elle chante au cours de la même représentation, un soir de 1990, à l’Opéra Bastille, pour pallier le forfait de Shirley Verrett en Didon)…

© The Metropolitan Opera Archives / Erika Davidson
En 1982, un producteur a une idée de génie : réunir Grace Bumbry et Shirley Verrett sur l’affiche d’un concert, au Carnegie Hall de New York. Les relations entre les deux prime donne n’ont pas toujours été au beau fixe, une forme de « rivalité » s’est instaurée entre elles et leurs supporters respectifs au fil des ans (faut-il s’en étonner s’agissant de deux cantatrices noires américaines évoluant exactement sur le même territoire ?), mais elles acceptent. D’autant plus volontiers qu’il s’agit de fêter les 80 ans de la « pionnière » Marian Anderson (85 en réalité, puisqu’elle s’était rajeunie dans sa biographie officielle !), première cantatrice de couleur à avoir franchi les portes du Metropolitan Opera, en 1955.
Malgré des répétitions houleuses, le concert, repris à Londres, puis à Los Angeles, San Francisco… est un succès. Filmé pour la télévision au Covent Garden, en 1983, mais hélas indisponible en DVD, il démontre à quel point les catégories vocales dans lesquelles on veut enfermer les chanteuses sont beaucoup plus perméables qu’on ne pourrait le croire… Verrett y incarne La Gioconda, Adalgisa et Aida face à Bumbry en Laura, Norma et Amneris, mais elles auraient tout aussi bien pu inverser les rôles ! Soprano, mezzo, « falcon » ? En fait, la question n’a plus d’importance. L’essentiel reste la leçon de chant et de théâtre offerte par deux divas déchaînées… et résolues à ne surtout pas laisser la vedette à l’autre !
De la diva, Grace Bumbry avait tout : l’allure impériale quand elle vous recevait dans la suite de son hôtel cinq étoiles, la pointe de condescendance et d’autosatisfaction quand elle évoquait sa carrière, sans oublier le coup de griffe facile… Voici, par exemple, la manière dont elle racontait, en 1989, dans les colonnes du magazine Opéra International, l’enregistrement de Don Carlo, en 1965 : « Decca me demanda d’arriver à une date impérative et je n’ouvris finalement la bouche que huit jours plus tard ! Dans l’intervalle, j’avais eu le temps d’attraper un rhume, localisé heureusement dans les sinus… donc sans conséquence pour la voix. Pourquoi ce retard ? Tout simplement parce que le staff de Decca était aux petits soins pour Renata Tebaldi, l’entourant, la couvant, lui évitant les courants d’air, les contrariétés… Elle venait, je crois, de perdre sa mère, elle était restée un certain temps absente des studios… bref, ils enregistrèrent toutes ses scènes en priorité ! ».
En même temps, elle ne manquait ni d’humour (« Je dois avouer qu’Aida, comme Sélika dans L’Africaine, m’offre l’inestimable avantage d’éviter tout maquillage ! »), ni de profondeur. En témoigne la manière dont elle évoquait, justement, cette question du maquillage dans la suite de l’entretien susmentionné : « C’est une nécessité vitale. Sans lui, je n’entrerais jamais en scène. Le maquillage, comme le costume, les bijoux, m’aident à oublier ma propre personnalité. Comment voudriez-vous, sans cela, que j’incarne Lady Macbeth ou Tosca ? Au fond de moi-même, je sais bien qu’une reine d’Écosse au Moyen Âge n’était pas noire, qu’une cantatrice romaine au début du XIXe siècle n’était pas noire ». Sur ce sujet, Grace Bumbry avait, encore récemment, apporté une réponse cinglante à la soprano Angel Blue, qui s’était retirée d’une production de La traviata aux Arènes de Vérone, pour dénoncer l’usage du blackface par Anna Netrebko : « Depuis cinquante ans que je chante à l’opéra, j’ai toujours utilisé le maquillage blanc, quand c’était nécessaire, et le maquillage noir, quand c’était nécessaire aussi. Bien sûr, ma préférence va au maquillage du visage en noir, mais pour être parfaitement honnête, cette préférence va à l’encontre de mon sens artistique de la crédibilité. Mon armoire à maquillage va de l’égyptien foncé au blanc de craie pour Turandot, en passant par toutes les couleurs intermédiaires. »
Dans la grande tradition des divas, l’histoire des adieux de Grace Bumbry tint du feuilleton. En 1997, elle annonça qu’elle quittait la scène, sur une ultime prise de rôle : Klytämnestra dans Elektra, à Lyon, dans le cadre imposant du Théâtre Antique de Fourvière. Il s’agissait certes d’un emploi de mezzo-contralto, marquant un complet retour en arrière par rapport à tout ce qu’elle avait accompli depuis près de trente ans. Mais, puisque c’est la « der des der », pourquoi pas ? Une fois les représentations terminées, fidèle à son engagement, elle se consacra exclusivement à sa carrière de concertiste et d’enseignante.
Jusqu’en 2010, quand Jean-Luc Choplin, le directeur du Châtelet, la convainquit de faire son retour, après treize années d’absence, dans Treemonisha de Scott Joplin. Elle y jouait Monisha, la mère de l’héroïne, avec une allure et un aplomb intacts, même si la voix, à 73 ans, n’avait plus, bien évidemment, la lumière de jadis. Décidée à retenter l’expérience, Grace Bumbry enchaîna avec la Vieille Dame dans Candide de Bernstein, en 2012 à Berlin, en version de concert, puis avec la Comtesse de La Dame de pique, en 2013, sur la scène du Staatsoper de Vienne. Uniquement des emplois de mezzo-contralto, dans lesquels ses dons de comédienne et son aura lui valurent d’incroyables triomphes.
Alors que, chantant encore en concert en 2015, elle avait laissé la porte ouverte pour d’autres occasions, il faut désormais se résoudre à dire adieu à l’une des plus phénoménales chanteuses-actrices du XXe siècle.
RICHARD MARTET