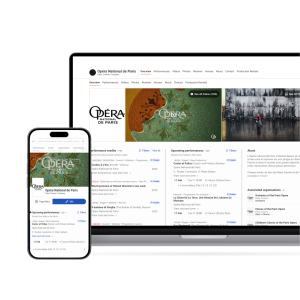Il y a très exactement cent ans, le 8 avril 1921, à Ancône, naissait l’un des plus grands ténors du XXe siècle. Disparu en 2003, Franco Corelli avait tout pour lui : un physique d’Apollon, une voix d’or, une passion et une générosité communicatives. Ce qui ne l’a pas empêché de soulever de vifs débats autour de sa manière de chanter et de conduire sa carrière, qui se poursuivent encore aujourd’hui. Jean Cabourg lui rend hommage, en attendant, espérons-le, le coffret exhaustif que Warner Classics, désormais propriétaire du catalogue EMI, se doit de lui consacrer. Au fil de ses différentes compilations, la multinationale, en effet, n’est jamais parvenue, depuis que le CD existe, à rééditer les récitals de l’artiste dans leur intégralité !
Le dialogue de la mer et de la terre natale de ce grand parmi les grands ne semble pas avoir accompagné une vocation musicale précoce chez le jeune Franco Corelli, trop occupé à suivre les cours destinés à faire de lui un géomètre d’Ancône, capitale des Marches. Les conseils d’un ami baryton le conduiront néanmoins, chemin faisant, à faire valoir ses dons naturels auprès du légendaire Conservatoire de Pesaro. Une audition et quelques leçons le persuadent bientôt de travailler sa voix en autodidacte, avec l’aide de vieilles gravures de chanteurs de l’âge d’or, méthode à laquelle il restera longtemps attaché.
Trois mois passés au cours de perfectionnement du Teatro Comunale de Florence, un échec au Concours « Teatro Lirico Sperimentale » de Spolète, précèdent alors sa réussite à ce même concours, en 1951, avec un « Celeste Aida » diversement apprécié. La voix en impose, quoi qu’il en soit, malgré ses inégalités. Pour ses débuts dans cette même ville, dès le 26 août suivant, plutôt que Radamès, le ténor, déjà âgé de 30 ans (1), choisit Don José dans Carmen, un rôle pour l’heure tout d’italianità pré-vériste. La couleur est encore barytonale, l’extension limitée, le vibrato indocile, la dynamique réduite : toutes limites perçues par les connaisseurs et que l’intéressé va entreprendre de dominer avec une ténacité peu commune.
En 1952, après avoir abordé, à Rome, le héros de Giulietta e Romeo de Zandonai et Maurizio d’Adriana Lecouvreur, en marge de ses Don José, il y paraît curieusement en Grigori dans Boris Godounov, sous la baguette de Vittorio Gui. 1953 voit le jeune espoir plus sérieusement confronté, en Pollione, à la Norma de Maria Callas, toujours dans la capitale italienne, en une rencontre dont les suites appartiennent désormais à l’histoire. Le premier enregistrement sur le vif de cette voix entre toutes prometteuse est capté la même année, à Florence, au cours d’un surprenant Guerre et Paix de Prokofiev. Avant de retrouver Pollione et Callas, à Trieste, en novembre, le ténor alterne Don José avec Canio dans Pagliacci, première confrontation, à Rome, puis à Spolète, avec un répertoire, cette fois, ouvertement vériste.
On note, dès 1954, une autre prise de rôle décisive, celle du Don Carlo verdien, avant un improbable Achille d’Iphigénie en Aulide de Gluck, toujours à Rome, puis Enrico d’Agnese di Hohenstaufen de Spontini, à Florence. Débuts en vérité assez désordonnés, quoique excitants dans leur diversité, d’une voix qui se cherche autant qu’on la recherche. Y compris au plus haut niveau, puisque, dès le 7 décembre de cette année ô combien éclectique, Franco Corelli est affiché à la Scala de Milan, en compagnie de Maria Callas, dans La Vestale du même Spontini, où sa voix pourprée et son geste ample font merveille en Licinius.
Se préciseront assez vite, dorénavant, les traits spécifiques d’un chanteur jusqu’alors dispersé et qui, coup sur coup, va capitaliser le meilleur de ses dons à la faveur de fécondes opportunités. En 1955, Corelli n’incarne-t-il pas son premier Dick Johnson dans La fanciulla del West, à Venise, son premier Radamès complet, à Vérone, et son premier Mario Cavaradossi dans Tosca, pour la télévision italienne ? L’année 1956, marquée par sa première intégrale de studio (Aida pour Cetra), culmine avec Loris Ipanov dans Fedora, à la Scala, de nouveau en compagnie de Callas, sous la baguette de Gianandrea Gavazzeni, lequel affirme n’avoir jamais admiré un couple aussi éblouissant. Sans compter que Giordano lui offre, avec Andrea Chénier, abordé en mars 1957, à Naples, l’un de ses emplois anthologiques.