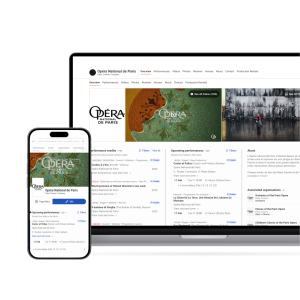Le centenaire de la naissance de Boris Vian (1920-1959) permet de retracer son rapport avec la musique classique. Élevé dans un milieu familial où l’on cultivait le grand répertoire, et où il compta Yehudi Menuhin comme camarade de jeu, celui qui fut, tout à la fois, écrivain, journaliste, trompettiste, chanteur, ingénieur, directeur artistique et bien d’autres choses encore se passionna, avant tout, pour le jazz. Mais, dans les dernières années de sa trop courte vie, l’opéra apparut comme un nouveau terrain de créativité, permettant la convergence de ses multiples talents.
On connaît sa passion pour le jazz, plusieurs de ses chansons sont passées à la postérité, mais on sait moins que Boris Vian, surtout à la fin de sa vie, fut attiré par l’opéra et s’y essaya même à plusieurs reprises. Alors que se termine une année de centenaire riche en commémorations et publications, retour sur une relation d’amour/haine conditionnée – -forcément – par les expériences de l’enfance.
Tout, dans son milieu familial, aurait pu conduire le jeune Boris à la musique classique. Son grand-père paternel, Henri Vian, bronzier d’art réputé, avait sa loge à l’Opéra de Paris. Son père Paul, né dans une aisance suffisante pour pouvoir vivre de ses rentes, fréquentait lui aussi les grandes institutions musicales de la capitale : Palais Garnier et Salle Favart, Concerts Colonne et Pasdeloup. Mais c’est plus encore sa mère, Yvonne Ravenez, harpiste, pianiste, qui est passionnée de musique.
Les prénoms des enfants balaient la vie musicale française du siècle écoulé, souligne François Roulmann, l’un des meilleurs spécialistes actuels de l’œuvre de Vian – il a collaboré à l’édition de la Pléiade, rédigé l’introduction au volume 10 (Opéras et -spectacles) de l’œuvre intégrale publiée chez Fayard et coécrit, avec Christelle Gonzalo, Anatomie du Bison, chrono-bio-bibliographie de Boris Vian (Éditions des Cendres, 2018) : « Lélio, l’aîné, c’est évidemment Berlioz, avec ce sous-titre évocateur de Retour à la vie. Alain, le troisième fils, se réfère au personnage de Grisélidis de Massenet. Et Ninon, la cadette, c’est bien évidemment Musset à travers la Sérénade de Delibes. »
Boris, là-dedans, fait presque tache. S’éloignant du cadre français, le prénom est emprunté au Boris Godounov de Moussorgski, dont la création -parisienne, en 1908, avec Chaliapine avait fait forte impression. Un prénom presque prémonitoire pour Vian qui devra, jusque dans les paroles d’une de ses chansons, L’Âme slave, se défendre de l’ambiguïté de cette identité : « J’ai l’air slave/Je suis né à Ville-d’Avray/Mes parents étaient bien français. »
Cette éducation musicale laissera des traces chez les enfants Vian, mais peut-être pas celles attendues par leurs parents. Surtout pas par « Mère Pouche », pour reprendre le surnom affectueux donné par les jeunes Vian à leur maman – sans doute en référence à l’opérette Pouche d’Henri Hirchmann, selon François Roulmann. Lélio jouera de la guitare, Boris de la trompette, Alain de la batterie et, bien loin de l’opéra, le concert de Duke Ellington, donné au Palais de Chaillot, en 1939, sera l’un des événements marquants de la vie du futur écrivain.
Outre cette passion pour le jazz – et le besoin naturel pour tout adolescent de trouver des références différentes de celles de ses parents –, un autre événement aura également contribué à éloigner Boris Vian du classique. Suite au krach boursier de 1929, Paul Vian perd une bonne partie de ses revenus : il doit non seulement trouver du travail, mais aussi réduire son train de vie. Il met en location « Les Fauvettes », sa villa de Ville-d’Avray, pour s’installer, avec femme et enfants, dans la maison du gardien, après y avoir fait ajouter un étage. Ses locataires seront les Menuhin, une famille américaine dont le fils, violoniste prodige, veut se rapprocher de son maître Georges Enesco : Yehudi a quatre ans de plus que Boris, mais l’image des deux garçons jouant ensemble aux échecs dans le jardin de Ville-d’Avray fera date dans l’iconographie officielle. Elle figurera même dans le programme d’un concert donné par Menuhin à la Salle Pleyel, en 1931, marquant ainsi la première apparition photographique publique de Vian.
Quels sentiments les jeunes Vian peuvent-ils nourrir à l’égard de la famille Menuhin ? L’admiration est évidente, mais on ne peut exclure une pointe d’agacement envers le fils prodige qui joue du violon, six heures par jour, dans ce qui était leur maison d’enfance. Cause ou effet ? Boris Vian professera longtemps une aversion pour la musique écrite, bien moins intéressante, selon lui, que la musique improvisée.
Peut-être est-ce aussi de Yehudi Menuhin que vient cette détestation de Mozart, qui le conduira notamment à transformer, dans Mozart avec nous, la Marche turque en cha-cha-cha ou à imaginer, dans En avant la zizique, une « machine qui composera tout ce que Mozart aurait composé s’il avait vécu plus vieux ». À moins qu’il ne s’agisse simplement d’un sain manque de respect pour les icônes, qui le verront également se moquer de Haydn (« musique de petite grand-mère sautillante ») ou de Beethoven (« capitaine des pompiers »). Avec une certaine constance : quand il s’ouvrira peu à peu à la « grande musique », ce sera pour préférer nettement la Seconde École viennoise à la Première.