Parce qu’il était « prêt à s’abandonner, et à accepter de ne rien comprendre », Thomas Dolié fut choisi pour être Papageno dans Une flûte enchantée d’après Mozart, dernière adaptation d’un opéra créée par Peter Brook, en 2010. Transformé par cette expérience singulière, le baryton français se souvient du sage des Bouffes du Nord, disparu le 2 juillet.
« Le propre d’un génie, c’est qu’on ne sait pas dire pourquoi il en est un ». Cette phrase, qui selon toute vraisemblance n’est pas de moi, me revient sans cesse en tête depuis que j’ai appris la disparition de Peter Brook. Elle résume vraiment mon expérience avec lui. Il vous regardait, et vous voyait comme aucun autre – et ne vous lâchait pas tant qu’il ne voyait pas la même personne sur scène. Souvent, pendant les répétitions, où nous improvisions beaucoup, il ne parlait pas. Et quand il avait quelque chose à dire, il venait nous voir individuellement. Jamais il ne nous demandait de faire ci ou ça, ou d’aller à tel moment, à tel endroit. Il nous racontait plutôt une histoire, et attendait de voir ce que cette parole allait provoquer en nous.

Un jour, il m’a dit : « Je voudrais que tu oublies tout ce qu’on a pu te dire sur ce personnage. Parce que cela ne m’intéresse pas. Ce qui m’intéresse, c’est toi, la personne que j’ai vue à l’audition – et que je ne vois plus, parce que je sens que tu essaies de faire ce qu’on t’a appris. » Quand vous entendez cela de la bouche de Peter Brook, vous avez les genoux qui tremblent un peu, et vous vous dites qu’effectivement, tout ce qu’on vous a appris ne vous ressemble pas, et qu’il suffirait peut-être de faire ce que vous, avez envie de faire. C’est très libérateur. Et un peu angoissant, aussi.
Pendant la tournée, qui a duré trois saisons, j’ai appris la difficulté de la fraîcheur. Et donc à me méfier des marques, des automatismes qu’on prend souvent dans les mises en scène, à l’opéra – ce qui se justifie, parce que les paramètres sont tellement multiples que le fait d’être sur des rails permet de penser au chant, à autre chose. Pour Peter, c’est vraiment l’ennemi absolu : il fallait que les choses soient toujours nouvelles. Mais quand on fait deux cents représentations, c’est dur de se réinventer ! À chaque fois que nous arrivions dans un nouveau théâtre, il fallait que nous fassions un filage. J’y mettais de la mauvaise volonté, car j’avais l’impression, lors des dernières séries, de gaspiller les spectacles « frais » que j’avais encore en réserve. Parfois, Peter et Marie-Hélène Estienne, sa collaboratrice, venaient à ces filages, et observaient. C’était terrible, parce qu’ils pouvaient nous dire : « Cette scène que tu joues depuis le début ne marche plus du tout. Fais autre chose. » Et quand on leur demandait quoi, ils répondaient : « Tu trouveras ce soir. »
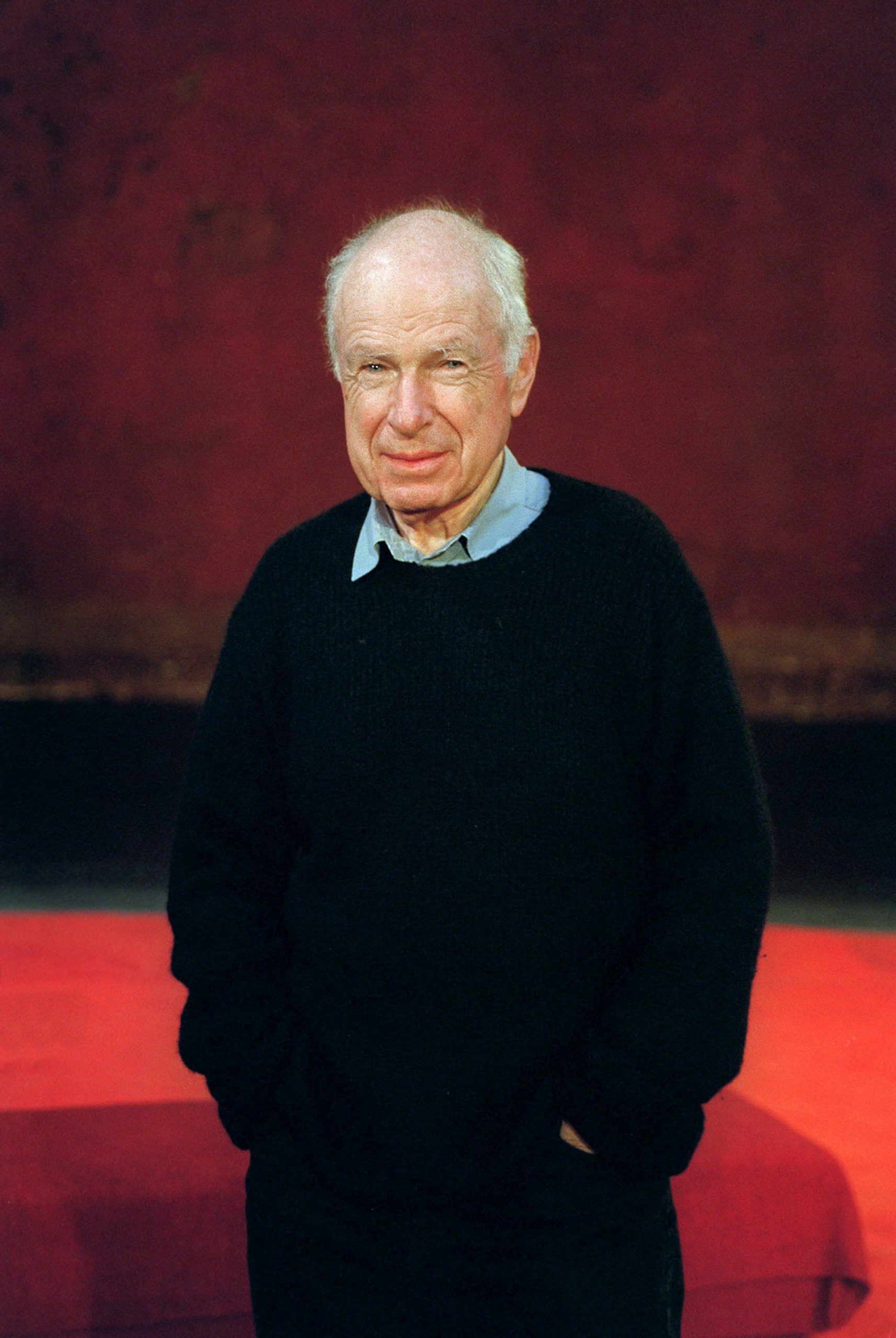
Je n’ai jamais entendu Peter dire, au contraire d’autres metteurs en scène, que l’opéra était moins théâtral que le théâtre. Il aimait profondément la musique, et peut-être est-ce l’oreille la plus incroyable que j’aie croisée. C’était aussi, d’une certaine manière, un grand chef d’orchestre. Pour lui, les gestes théâtral, musical, vocal ne devaient faire qu’un. Cela passait par une grande liberté, et une autonomisation du chanteur – qui, à l’opéra, peut être finalement très passif. Il fait de la musique comme le chef le lui demande, joue comme le metteur en scène le lui indique. Et s’il peut être force de proposition dans le travail, il est rarement à l’initiative des choses. Pour Peter, le principal était que tout vienne de l’acteur. J’essaie de garder cela avec moi dans tout ce que je fais depuis. Même s’il faut lutter pour retrouver cette liberté. »
Propos recueillis par MEHDI MAHDAVI











