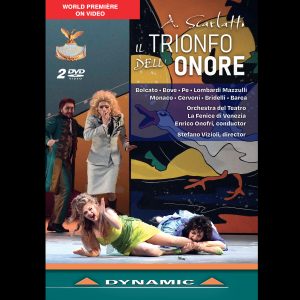Opéra-Comique, 17 mars
À voir ce spectacle, on s’étonne du large consensus favorable qui a entouré sa création aixoise, en juillet dernier. Divergeant en cela avec Mehdi Mahdavi (voir O. M. n° 205 p. 24 de septembre 2024), nous le trouvons en effet très problématique dans sa conception même. Malgré une communication mettant en avant une « enquête » sur cette collaboration avortée entre Rameau et Voltaire, ce dernier est le grand absent du résultat final, hors quelques bribes de son livret publié (certes différent de la version initiale). Même les passages ayant attiré la censure, comme « Peuple, éveille-toi, romps tes fers ! », sont ignorés.
Le livret, concocté par Claus Guth et Raphaël Pichon, avec le dramaturge Eddy Garaudel, adaptant au forceps – et avec pas mal d’amateurisme prosodique – les textes d’airs et ensembles puisés dans divers ouvrages de Rameau, a l’énorme défaut de ne pas permettre de raconter l’histoire ! La narration, en plus du flash-back parlé plein de pathos de la mère de Samson (Andrea Ferréol), doit donc recourir parfois à des pantomimes, le plus souvent à des citations projetées du Livre des Juges de l’Ancien Testament – un peu trafiquées, car, par exemple, Timna y est un lieu, et non une personne. En l’absence, délibérée, de récitatifs (Voltaire, lui, désirait les réduire), les moments clés de l’action, comme l’aveu par Samson que sa force réside dans sa chevelure, ne passent jamais par ce qui est chanté. La fonction de la musique est donc d’illustrer des tableaux successifs, avec un bonheur inégal, car les pièces du montage sont souvent en porte-à-faux par rapport à leur affect ou leur situation d’origine (« Tristes apprêts », typiquement). Le choix effectué produit en outre un effet Les plus Belles Pages de Rameau, avec trop de chefs-d’œuvre juxtaposés, une surdose de Zoroastre, et des jointures mal masquées par les lourds effets sonores ajoutés.
Nous ne reviendrons pas sur l’aspect scénique (mais cette fin christique est-elle bien voltairienne d’esprit ?). Sous une direction qu’on a connue plus subtile, orchestre et chœur Pygmalion sont bien sonnants, mais ce dernier paraît souvent embarrassé par son texte bricolé.
Samson à l’indéniable charisme physique, le baryton Jarrett Ott a amélioré son français depuis Aix, mais le grave reste court et le style quelconque. La haute-contre Laurence Kilsby chante avec aisance et éclat, y compris des parties de dessus (Érynice). Parmi les nouveaux sur la production, Camille Chopin (de l’Académie de l’Opéra-Comique) est un Ange très bien projeté mais un rien scolaire, et la basse Mirco Palazzi un Achisch plus juste d’intonation que Nahuel di Pierro, mais avec moins d’autorité. Ange aixois, Julie Roset prête ici son timbre lumineux à Timna, personnage psychologiquement mal défini, comme l’est Dalila, où Ana Maria Labin, autre nouvelle venue, peine à trouver ses marques malgré de réelles beautés vocales.
THIERRY GUYENNE