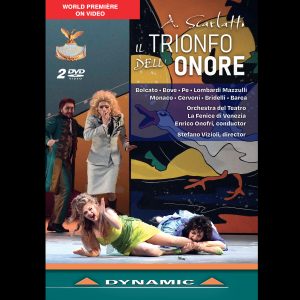Staatsoper, 15 mars
Le retour de Norma à Vienne, après quarante ans d’absence, qui plus est sur deux scènes en parallèle (voir O. M. n° 211 p. 69 d’avril 2025), rendait inévitable la comparaison entre les deux spectacles. Et ce d’autant plus que le Pollione de l’une (Freddie de Tommaso) a même traversé le Ring, profitant d’un soir de relâche au Theater an der Wien, pour aller à la Staatsoper jouer les remplaçants de luxe de Juan Diego Flórez, indisposé pour deux représentations (l’autre substitut aura été Dmytro Popov).
Sur le papier, c’est-à-dire dans l’interview publiée dans le programme de soirée, la proposition scénique de Cyril Teste est riche d’intentions, de détails et de références (de Peter Brook à Andreï Tarkovski) pour expliquer l’actualité de l’action, des décors et des costumes. Les Gaulois sont ici des victimes de guerre et des réfugiés et, si l’attirail des Romains emprunte parfois plus à l’armée allemande de la Seconde Guerre mondiale qu’aux troupes russes, la référence revendiquée à l’invasion de l’Ukraine est patente.
Mais la transposition ne suffit pas à créer de la modernité : faute d’une direction d’acteurs rigoureuse, on a juste le sentiment d’avoir troqué le naturalisme habituel pour un autre. Le folklore ukrainien se substitue à celui du petit village gaulois qui résiste à l’envahisseur, les gestes guerriers sont convenus et maladroits, les accessoires – fusils ou petites lampes agitées par les protagonistes – ajoutent à la naïveté, tout comme le recours à une chorégraphe pour faire vaguement danser les paysannes. Et l’idée de glisser dans le programme une carte de senteurs élaborée par un parfumeur parisien, celui-là même auquel Teste avait déjà fait appel pour embaumer la salle lors de sa Salome donnée ici en février 2023, pour ajouter une dimension olfactive aux sons et aux visuels ne fait qu’ajouter à un sentiment global de bric et de broc.
Comme à son habitude, Teste double sa mise en scène de vidéos en direct, sous la forme de détails agrandis et projetés sur un écran de tulle tendu devant la scène. Mais, cette fois, le procédé n’est pas créateur de sens.
Deux chanteuses de la nouvelle génération dominent le plateau. Avec sa haute stature et son autorité naturelle, Federica Lombardi séduit en Norma : les lignes sont soignées, l’intonation sans faille et l’expressivité oscille idéalement entre le suave et l’énergique. On pourrait rêver de plus de netteté dans les coloratures de « Ah bello a me ritorno », mais on se pâme plus loin pour quelques très beaux aigus filés. Il manque encore juste un peu d’abandon, de lâcher-prise, pour que l’incarnation bouleverse vraiment. Vasilisa Berzhanskaya a gardé la souplesse de l’époque où elle chantait La Reine de la nuit, mais elle a aussi le grave d’Isabella, ce qui donne à son Adalgisa une riche palette de couleurs et de nuances, et offre un équilibre intéressant dans les duos avec Norma.
Du côté des anciens, Ildebrando D’Arcangelo campe un Oroveso attachant, sonore dans le registre supérieur, mais presque éteint dans les notes graves. Même si la voix n’a plus la projection et le rayonnement solaire qu’on lui a connu, Juan Diego Flórez reste un Pollione d’une grande fiabilité, à l’intonation parfaite, aux phrasés élégants et aux légatos suaves.
Pour ses débuts à la Staatsoper – il assure cette seule représentation, toutes les autres étant confiées à Michele Mariotti – Antonino Fogliani ne convainc pas vraiment. Dès l’ouverture, la battue semble précipitée, et on regrette ensuite un manque d’ampleur, de respiration et surtout de rubati : « Casta Diva », trop plat et trop carré, est la première victime notable. Nervosité des débuts ? Il faudra attendre les derniers moments du spectacle pour trouver enfin les alanguissements qu’on attendait plus tôt.
NICOLAS BLANMONT