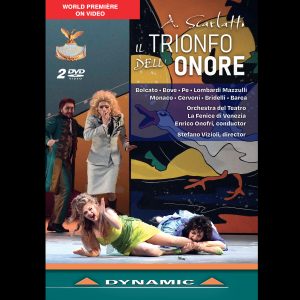Opéra, 14 mars
Quatre décennies que la capitale des Gaules n’avait plus entendu La forza del destino, plat de résistance du festival de printemps de l’Opéra de Lyon, intitulé cette année « Se saisir de l’avenir ». La mise en scène d’Ersan Mondtag propose un retour aux décors de carton-pâte – et par extension aux précipités entre les différents tableaux –, avec ce qu’il faut de stylisation pour susciter l’intérêt. Les arcades à pilastres corinthiens qui ouvrent le spectacle, le monastère de Hornachuelos et sa façade peinte de pendus et décapités, dont le balcon repose sur un ossuaire, sous l’orbite d’un énorme crâne, et l’hôpital de campagne de l’acte militaire dans un ancien théâtre offrent un cadre évocateur. L’idée de fondre en un lieu unique l’acte II ne coince qu’au moment où Léonore lance avec soulagement « je suis arrivée », alors qu’elle n’est descendue que d’un étage depuis le début de l’acte. La direction d’acteur est d’une naïveté désarmante, les choristes étant sans cesse en mouvement dès les premières notes de l’ouverture, avec une gestuelle kitsch d’opéra d’antan.
Même si les metteurs en scène ne sont pas là pour sauver les dramaturgies médiocres, du moins savent-ils parfois contourner certaines maladresses. Rien de tel ici, face aux revirements psychologiques soudains des personnages, à leur obstination caricaturale, et à cette péripétie carrément tarte du coup de feu malencontreux qui scelle le fameux destin du titre. Et ce ne sont pas les cornettes à oreilles de lapins des femmes cantonnées à la fabrication des obus ou aux soins des blessés qui redoreront le blason d’un ouvrage il est vrai assez boiteux. Plus qu’une mécanique théâtrale efficace, la partition est d’ailleurs un patchwork de moments glorieux, qui nécessite un travail de continuité que ne prodigue qu’insuffisamment le geste très séquentiel de Daniele Rustioni. L’ouverture, déjà, ne tient pas la distance de son con fuoco initial. Et si certains moments sont saisissants (la piété de l’évocation chorale de Sainte-Marie-des-Anges), l’ensemble manque de cohésion, sans empêcher un plateau honorable de distiller le frisson attendu. Passons sur le Marchese di Calatrava renfrogné de Rafał Pawnuk pour louer d’emblée les comprimari de l’habituelle version révisée (1869) de la partition : Trabuco savoureux de caractérisation de Francesco Pittari et Melitone presque teigneux de Paolo Bordogna. La Preziosilla sans vraie assise vocale de Maria Barakova décoche de coupants aigus, mais peine à faire sonner les graves de son « Rataplan ».
ArIunbaatar Ganbaatar assume un Don Carlo très vindicatif, avec une grosse voix de baryton-basse digne d’un géant wagnérien, presque trop sombre pour le frère de l’héroïne, mais d’une sûreté et d’un impact réels. Dans la nuance piano de ses « Buona notte », on perçoit d’ailleurs un naturel d’émission qui, généralisé à la piena voce, ferait sans doute merveille. Il manque surtout à Riccardo Massi un timbre plus rayonnant pour tenir un grand Don Alvaro, la conduite de la ligne, la beauté des doubles consonnes et la solidité du troisième registre étant tout à fait à la hauteur des enjeux. Hulkar Sabirova donne une Léonore fragile, touchante par sa sincérité, mais aux prises avec une technique récalcitrante, fragmentant les longues phrases par plusieurs respirations, mal à l’aise dans un bas-médium assez grêle, avec un vibrato parfois long à l’allumage. Enfin, même avec la matière un peu altérée par les ans, Michele Pertusi reste un Padre Guardiano déroulant son autorité morale avec une voix de violoncelle, d’une rondeur, d’une réserve de puissance distillant sa foi avec une autentica qualità.
YANNICK MILLON