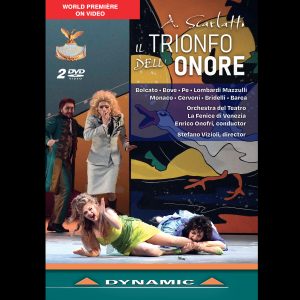Bayerische Staatsoper, 21 mars
Mettre en scène la tragédie de Kát’a Kabanová, jeune femme hypersensible, prisonnière d’une province russe oppressante, requiert d’exacerber une situation de huis clos, d’inéluctable enfermement, sans autre échappatoire que cette Volga qui coule quelque part en aval, fleuve tumultueux dans lequel l’héroïne finit par se précipiter pour disparaître. À Salzbourg, dans deux productions restées célèbres, les dos tournés des centaines de mannequins de Barrie Kosky ou la cour intérieure sordide de Christoph Marthaler actionnaient efficacement ce genre de levier. À Munich, Krzysztof Warlikowski et Małgorzata Szczęśniak n’inventent rien de très nouveau, mais comment le pourraient-ils après de tels précédents ?
Peut-être, justement, en prenant le défi à contrepied, en ouvrant l’espace, en plaçant la Volga au centre même du dispositif, comme le faisait si poétiquement Robert Carsen. Vers la fin de son spectacle, Warlikowski essaie effectivement d’élargir le cadre, avec l’immense projection d’un champ de pissenlits, longuement animée sur le mur du fond, suivie d’un brutal effet de bascule vers l’élément liquide lors du suicide, mais il est tard. Auparavant, il aura fallu subir quatre-vingt-dix minutes sans entracte, dans une salle des fêtes où les membres souvent âgés d’un club de danse s’exercent sans fin au tango, face à un juke-box et un aquarium, avec parfois un bar d’eau minérale ouvert à l’arrière-scène. Seule échappatoire : aller copuler, peu discrètement, dans les toilettes au fond à droite, ce que feront successivement, au II, Varvara et Kudrjáš, puis Kát’a et Boris. Dans ce monde à la fois très social et carcéral, Warlikowski s’intéresse beaucoup à certaines situations, comme la bascule irrémédiable après la faute, Boris ressortant des toilettes masqué de blanc, anonymisé comme dans une tragédie grecque, mais en néglige d’autres, telle l’influence clé exercée par Varvara et Kudrjáš, candide souffle d’air frais et de juvénilité que le projet scénique échoue à valoriser.
Références cinématographiques, comme d’habitude chez Warlikowski, avec ici l’influence patente du film Ballando, ballando, d’Ettore Scola, et d’autres citations plus fugaces, voire difficiles à décrypter. Et puis, bien sûr, toujours les mêmes tics (personnages assis ou fumant une cigarette…). Un usage attendu, aussi, de la vidéo en temps réel, techniquement bien maîtrisée, et qui surtout ne laisse rien perdre de la fantastique performance d’actrice de Corinne Winters, qui incarne avec une intensité croissante un rôle auquel son physique menu de femme-enfant la prédispose idéalement. Même la voix, auparavant voilée et manquant de fermeté dans l’aigu, a pris de l’ampleur. Cela dit, l’intensité de la composition est telle que l’on continue à davantage la regarder qu’à l’écouter, ce qui est très bien ainsi, car au moins, grâce à ce magnétisme visuel de Lolita fragile, tendre, voire complètement éperdue, la soirée résiste à une sensation d’ennui qui, sinon, s’imposerait peut-être de façon tuante.
L’autre spectacle est orchestral. Marc Albrecht crée de fastueux déchaînements, met en lumière chaque détail, mais oublie d’intégrer les voix dans un flux qui semble davantage couler devant la scène que valoriser un discours théâtral efficace. Dès lors, c’est surtout en fonction de leur expérience que les chanteurs tirent plus ou moins bien leur épingle du jeu. Certainement Pavel Černoch, avec d’autant plus de mérite qu’il n’est favorisé ni par le metteur en scène ni par le chef ; dans une certaine mesure aussi James Ley et Ena Pongrac (remplaçant une Emily Sierra souffrante), mais pas du tout Violeta Urmana, qui a certes la prestance scénique du rôle de Kabanicha, mais pas sa projection. À force de manquer de continuité de ligne et d’impact vocal, le rôle en perd beaucoup de son relief. Et puis, l’idée de Warlikowski de faire s’effondrer le personnage à l’extrême fin sous le poids du remords paraît discutable. S’il y a un rôle de Janáček pour lequel il faut s’acharner à sauver la face jusqu’au bout, sans jamais plier, c’est bien celui-là.
LAURENT BARTHEL