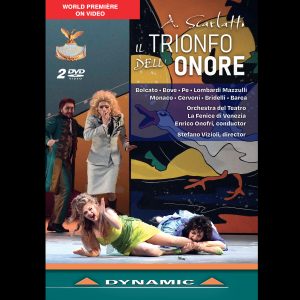Opéra Bastille, 6 février
Qu’est-ce qui fait une grande mise en scène ? Assurément le fait qu’on en garde la mémoire. Pour ces Puritani signé Laurent Pelly, créé en 2013 et repris en 2019 (voir O. M. n° 91 p. 53 de janvier 2014 & n° 155 p. 54 de novembre 2019), seul l’écorché tournoyant d’un manoir Tudor habilement dessiné par Chantal Thomas – mais pas vraiment idéal pour la projection des voix – demeurait comme image de référence, avec quelques fulgurances d’Elsa Dreisig, habitant Elvira d’un vrai délire en 2019.
Car cette production n’est pas du « grand » Pelly, qui est resté partagé entre tendresse pour cette héroïne que gagne l’hystérie du rôle et regard narquois face au livret : hallebardiers traversant la scène au trot, chœurs jouant les potiches, Christian Räth, qui reprend fidèlement la production, n’en transmet que sa forme de routine scénique. Que ne contrebalance pas tout à fait la baguette de Corrado Rovaris pour ses débuts locaux. Attaquée très vif, accentuée fortement, l’ouverture ne porte pas au rêve romantique, et l’orchestre devient un peu brouillon avec l’arrivée des chœurs, pas vraiment ensemble au début. Peu à peu, le sens de l’équilibre, la merveille du balancement mélodique de Bellini et de son élégance s’imposent cependant, pour porter les voix solistes à leur possible meilleur.
Cela n’arrive pas avec la basse Andrii Kymach, timbre noir, aigus puissants, mais lignes un peu frustes et vocalises assez rigides. L’inverse du très séduisant Roberto Tagliavini : timbre chaleureux et sombre, phrasés somptueux, son Giorgio se montre, au duetto « Il rival salvar tu dêi », le plus souple, et mène « Suoni la tromba » à l’excellence, même si l’aigu final de Riccardo l’emporte en puissance. Les petits rôles sont bien tenus par des membres de la troupe, Vartan Gabrielian, Manase Latu, et Maria Warenberg, reine bien présente.
Pas de grands Puritani sans un ténor d’excellence. Lawrence Brownlee passe tout l’acte I à chercher son souffle et sa projection, bien légère pour Bastille. Tout l’acte III le montre heureusement superbe, de legato, de cantilène et de couleurs retrouvées. Mais c’est Lisette Oropesa qui fait la soirée, même si l’actrice ne captive guère : au grand ensemble concluant l’acte I, magnifiquement partagé sur le plan musical, elle fait petite fille perdue qu’on aurait grondée, et non héroïne romantique prête à vaciller. Pas plus de faille intérieure déchirée dans « Qui la voce sua soave ». Mais c’est bien la maitrise vocale qu’on admire, la beauté du médium, l’agilité et la facilité de l’aigu (« Oh vieni al tempio »). De fait, le couple réuni à l’acte III comble enfin tous les désirs vocaux.
PIERRE FLINOIS