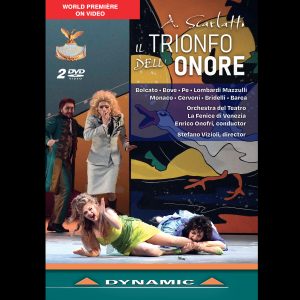Opéra, 7 mai
Son Rake’s Progress de 2022 si réussi plaçait haut l’attente face à la seconde production lyrique de Mathieu Bauer. Après l’Amérique des années 1950 pour Stravinsky, c’est dans l’univers d’une fête foraine vivement éclairée et colorée que le metteur en scène a choisi de transposer Die Zauberflöte. Son décor, monté sur une tournette, accumule les éléments les plus disparates : deux escaliers, une buvette, un train fantôme et sa tête de mort, une grande roue lumineuse ; le tout agrémenté d’une débauche de ballons et enrichi de quelques touches de vidéo. Sarastro est le patron de ce parc d’attractions et vient avant l’ouverture nous vanter les merveilles de l’opéra de Mozart. Tout le premier acte va se jouer dans un registre quelque peu anodin où manquent les prémices du chemin initiatique et dont les personnages sont des figures naïves ayant, pour la plupart, perdu leurs signes caractéristiques : les plumes de l’Oiseleur, la noirceur pour Monostatos ou son caractère surnaturel pour la Reine de la Nuit, habillée en cowgirl, façon Joan Crawford dans Johnny Guitar. La rencontre de Tamino et de l’Orateur trop léger de Thomas Coisnon devient une banale conversation, et le premier acte s’achève sur l’image de Sarastro distribuant des pommes d’amour, laissant le spectateur assez perplexe.
Le choix de donner l’intégralité des dialogues s’avère à double tranchant. S’ils instillent un intérêt supplémentaire à certaines scènes, comme celle des esclaves, ils paraissent souvent longuets, donnés par des chanteurs français qui ont fort à faire avec l’allemand et y perdent en naturel et en spontanéité. Il faut attendre le deuxième acte pour que la mise en scène transcende l’encombrant décor et en calme les rutilances, intégrant les différents éléments dans une dramaturgie qui mêle finement le sérieux des scènes maçonniques avec des touches d’humour qui font respirer ce qui jusque-là paraissait très figé.
Comme souvent, c’est l’humanité du propos qui triomphe à travers le délicieux Papageno de Damien Pass. Si la voix du baryton-basse paraît un peu large pour le rôle, il se l’approprie avec talent, se révélant particulièrement fluide dans le dialogue et d’une inventivité sans cesse renouvelée au plan théâtral, comme dans la scène de beuverie où il entraîne l’un des deux prêtres.
La reste de la distribution va de l’excellent au moins bon dans une gradation qui ne suit pas toujours l’importance des rôles. Le trio des Dames est dominé par le soprano puissant d’Élodie Hache. Nathanaël Tavernier offre à ce Sarastro bienveillant de splendides graves et une stature imposante. En Pamina, Elsa Benoit, un peu desservie par une affreuse robe typée années 1960, transcende ce handicap par une incarnation d’une grande sensibilité qui culmine dans son air de désespoir « Ach, ich fühl’s », donnant à son personnage de jeune première une puissance inhabituelle. Remplaçant Florie Valiquette en Reine de la Nuit, Lila Dufy se sort correctement de son premier air mais manque de soutien et d’énergie pour les fureurs du second. Seul germanophone, Maximilian Mayer prête une voix large à Tamino mais s’avère bien peu nuancé, avec des aigus en force qui donnent une tonalité uniformément héroïque au personnage. Excellents, le Monostatos de Benoît Rameau et la Papagena d’Amandine Ammirati, à qui son dernier duo avec Papageno vaut un beau succès. On regrette une fois de plus que les trois génies ne soient interprétés par des voix féminines, enlevant à leur rencontre avec Pamina au deuxième acte l’effet de contraste voulu par Mozart.
L’excellent chœur de chambre Mélisme(s) se recommande par la qualité des voix et son homogénéité, fournissant en outre les petits rôles secondaires des esclaves de Monostatos. Dans la fosse, à la tête de l’Orchestre National de Bretagne, Nicolas Ellis dirige une exécution très enlevée dont la sonorité d’ensemble, un peu lourde au démarrage, s’allège au fil de la soirée pour nous emmener dans les hauteurs aériennes du génie mozartien.
ALFRED CARON