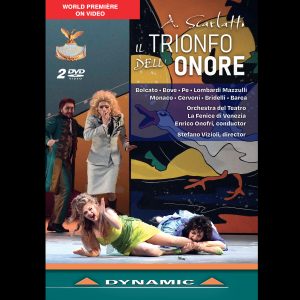Deutsche Oper, 30 janvier
Si le projet Strauss de Dmitri Tcherniakov à Hambourg restera dans les mémoires comme un véritable cycle, uni dans une démarche scénique cohérente, il n’en va pas de même du (faux) cycle Strauss de Tobias Kratzer à Berlin : trois opéras que rien ne rapproche, et sans autre propos commun, pour le moins ténu, que la transposition à notre époque. Alors que l’actualisation de Arabella et Intermezzo ne posait pas de problème majeur, ce n’est pas le cas avec cette Frau ohne Schatten qui revendique d’emblée un parti-pris de désenchantement (« Entzauberung »). Si le metteur en scène entend par désenchantement une forme de sécularisation du propos – disparition forcenée de tout le substrat magique/philosophique/initiatique de l’œuvre pour en faire une dénonciation du trafic d’êtres humains en Europe, comprenez une relecture au prisme de la seule question de la maternité –, le désenchantement est aussi pour le spectateur qui, noyé dans le réel le plus sordide, est privé de toute possibilité de rêve ou de poésie.
Rien de bien neuf, sans doute, notamment pour ceux qui connaissent le style Kratzer ou ont vu la production de Mariusz Trelinski à l’Opéra de Lyon. Pour les autres, ce sera « Mon faucon chez les Tuche ». Tandis que l’Empereur part en costume au bureau, l’Impératrice passe ses journées en pyjama de soie quand la Nourrice, façon Tootsie, ne la force pas à sortir pour une virée shopping dans les boutiques de luxe. La femme du teinturier tient un pressing et, entre deux machines, va subir une FIV (que l’on suit en vidéo) avant de faire une fausse couche. Les enfants mendiants sont gavés de malbouffe, le temple du troisième acte est une vaste couveuse dans un hôpital où un couple gay vient tranquillement choisir et emporter un nouveau-né, mais où l’Impératrice et la Nourrice se font arrêter par le Messager des esprits (qui, après avoir été un livreur de colis Amazon au premier acte, a été promu infirmier en chef). Barak et sa femme vont consulter une psychothérapeute (la voix d’alto) avant de divorcer devant notaire ; Keikobad est un vieux professeur de piano qui offre à sa fille la partition de l’opéra lors d’une gender reveal party, mais, en fin de compte, c’est quand même Barak qui va chercher sa (?) fille au jardin d’enfants.
Dans la fosse, avec un Orchestre du Deutsche Oper en grande forme, Donald Runnicles délivre une lecture puissante, sonore et intensément dramatique, plus d’une fois tellurique même dans les interludes de changements de décor. Mais le chef écossais, comme s’il avait voulu se mettre au diapason de la mise en scène, fait peu de cas des détails, contrechants ou moments rêveurs ; le final de l’acte I, notamment, se révèle assez plat.
On retrouve avec plaisir l’Impératrice solide et élégante de Daniela Köhler (même si l’excellent Olaf Winter, aux lumières, semble se soucier comme une guigne de l’ombre qu’elle projette). Sans être le plus charismatique des Empereurs, Clay Hilley séduit par sa vaillance, sa générosité et l’homogénéité de son timbre, même si la voix manque parfois de précision quand elle doit s’exprimer à pleine puissance dans le registre aigu. Un peu sur la réserve aux deux premiers actes, Jordan Shanahan semble comme libéré au troisième, délivrant une prestation de toute beauté. Face à lui, la Teinturière de Catherine Foster est comme sa Brünnhilde de Bayreuth : tout-terrain, tout en force, mais au prix d’une voix dure et peu colorée. On admire enfin le messager des esprits de Patrick Guetti, et on est, pour une fois, déçus par Marina Prudenskaya. Cela tient probablement à la conception du personnage par Kratzer, mais sa Nourrice semble insupportablement superficielle, caricaturale même, avec un chant anecdotique qui ne rend pas la noirceur attendue.
NICOLAS BLANMONT