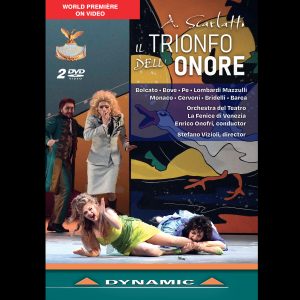Théâtre des Champs-Élysées, 21 mai
Sur la scène ouverte, on identifie les parois de pavés de verre de la Maison du docteur Dalsace à Paris, chef-d’œuvre de Pierre Chareau et Bernard Bijvoet de 1930. Au fond, sous un balcon rectiligne sans fioriture, des tables et miroirs de maquillage, et un lavabo, signature de Małgorzata Szczęśniak… Un curieux décor unique, dont Vienne est évacuée, autant que le XVIIIe siècle cher aux auteurs du Rosenkavalier.
Suspendu aux cintres, un grand écran, qui recevra à l’acte II la présentation de la rose du film muet de Robert Wiene (1925), accompagne l’explosion sensuelle du prélude, avec Véronique Gens et Niamh O’Sullivan allongées nues sous un drap blanc. Radieuses, elles respirent le bonheur des caresses avec un naturel confondant. Krzysztof Warlikowski profitera-t-il des « situations scabreuses » du livret pour défendre la théorie du genre ? Elle ne sera réservée qu’au contrepoint envahissant d’un Mohammed inventé, d’Hippolyte le coiffeur, d’un Leopold très break-dance, mais pas vraiment aux protagonistes principales, réduites au seul artifice théâtral, appuyé.
Contrairement à ses formidables productions straussiennes de Die Frau ohne schatten et Salome à Munich, d’Elektra à Salzbourg, Warlikowski ne croit visiblement pas en ces personnages de comédie, s’obstinant à leur refuser empathie et émotion : perruque blanche, droite, sa Maréchale, façon Cate Blanchett, se prête, complaisante, aux captations vidéo d’une Annina influenceuse et d’un Valzacchi preneur de son, pour ensuite s’interroger froidement sur son ennui. L’analyse sociale, qui épargne à peine Octavian, en veste afghane brodée, et un Ochs laissé à l’inexistence théâtrale, culmine avec une Sophie potiche, robe jaune serin et coiffe d’ingénue portée tout l’acte II face à l’oiseau bleu argent porteur de la rose attendue. De la fraîcheur, de l’émotion de la rencontre amoureuse, rien ne surnage, car les acteurs ont eu, quitte à passer sur leur rayonnement propre, le professionnalisme d’obéir au diktat d’une production volontairement décalée. Tant pis pour le partage de ce « Monde d’hier » à la mélancolie drolatique et irrésistible, qui ne pointe ici qu’au final, quand la Maréchale désabusée retrouve un mari compréhensif, qui sait ? Bronca pour l’équipe théâtrale, contrastant avec l’enthousiasme exprimé pour la partie musicale qui sauve la soirée d’adieux de Michel Franck au monde opératique de l’avenue Montaigne.
C’est d’abord le fait de la direction d’orchestre d’Henrik Nánási, vive, heureuse, chatoyante, jamais éteinte et surtout parfaitement au fait de la séduction du style straussien où, entre raffinement et somptuosité, l’Orchestre National de France puise aux rives de la perfection, sinon de l’émotion absolue. Parfois un rien trop sonore, il ne couvre jamais les voix, et leur laisse libre le champ de l’aisance.
Grande tenue vocale pour l’excellente Annina survoltée et pimpante d’Éléonore Pancrazi, le Valzacchi de Krešimir Špicer qu’elle écrase un peu, le Chanteur italien de Francesco Demuro, à la voix baroquisante aussi sculpturale que sa plastique de catcheur quasi nu. Faninal bien caricaturé dans son côté buté par un Jean-Sébastien Bou imposant. Si le Baron Ochs de Peter Rose garde toutes ses notes, il n’offre pas le rentre-dedans d’un rôle laissé trop pâle, et sans splendeur abyssale. Regula Mühlemann est une jolie Sophie aux aigus gracieux, sinon célestes, Niamh O’Sullivan, timbre profond aux couleurs riches de soies somptueuses, aux aigus magnifiques d’impact, un Octavian captivant.
Mais c’est Véronique Gens qui l’emporte sur tous. Rôle de longtemps désiré, appris en deux mois, elle y paraît idéale par la tenue et l’élégance de la ligne de chant, la souplesse ductile de l’aigu, la fermeté de la projection, la classe aussi. Elle s’affranchira vite du cocon de raideur de son monologue imposé par le metteur en scène, car elle fascine déjà à évoquer le temps qui coule face à un Octavian déboussolé, instants magiques d’une grande dame du chant. Ce soir, la Maréchale a trouvé pour notre aujourd’hui une nouvelle et bien belle incarnation.
PIERRE FLINOIS
.