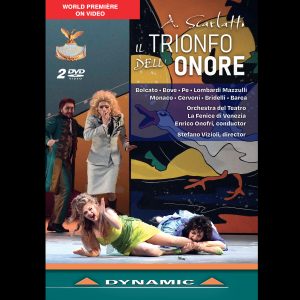Théâtre du Capitole, 16 mai
Der fliegende Holländer a été créé à Dresde en 1843 et un spectateur de l’époque ne se sentirait sans doute pas dépaysé en découvrant cette nouvelle production. À tort ou à raison, Michel Fau a voulu s’effacer devant une œuvre qu’il se garde de « relire » à la mode actuelle. Le beau décor du premier acte, avec ses deux navires côte à côte, se transforme ensuite en un imposant tableau enserré dans un lourd cadre de bois doré. Solistes et choristes ne disposent dès lors que d’un territoire étriqué sur le devant de la scène. Tout mouvement d’ensemble leur est quasi impossible. Seul leur chant laisse deviner leurs sentiments. Capuche rouge, torse nu, un Satan insolite vient par moments s’ajouter à eux. Impeccables costumes d’époque recréés par Christian Lacroix et lumières savantes de Joël Fabing contribuent à donner à cet ensemble résolument statique un cachet ancien, dont le principal mérite est de ne jamais entrer en contradiction avec ce que dit la musique.
Comme toujours au Capitole, la distribution se révèle solide et parfaitement homogène. Oublions donc pour un instant Hans Hotter, Leonie Rysanek, Anja Silja ou Hans Sotin pour saluer le remarquable travail effectué par des interprètes qui, dans leur grande majorité, effectuent là une prise de rôle. Avec son timbre somptueux et son intense présence dramatique, Aleksei Isaev campe un Hollandais fascinant qui, dans sa carrière, marque déjà une étape importante. Airam Hernández fait bénéficier Erik d’un lyrisme chaleureux qui donne aussitôt à son personnage une force d’émotion qui ne se dément pas d’un acte à l’autre. La superbe voix de basse de Jean Teitgen nous vaut un Daland de grande classe tandis qu’à ses côtés, Valentin Thill tire le meilleur parti qui soit du rôle parfois sacrifié du Pilote. Victime peut-être d’une mise en scène qui ne lui accorde guère d’importance, Eugénie Joneau peine à donner quelque relief à Mary.
Reste, au centre de cette distribution, Ingela Brimberg, venue remplacer Marie-Adeline Henry initialement prévue. Elle se retrouve là sur un terrain qu’elle connaît parfaitement. Son énergie vocale s’accompagne d’une discipline à toute épreuve, mais on regrette parfois que cette soprano suédoise, affichée fréquemment en tant que Brünnhilde ou Turandot, ne laisse que peu transparaître ce qui relie Senta aux héroïnes du premier romantisme.
Habitué désormais du Théâtre du Capitole, où il a dirigé avec succès plusieurs ouvrages germaniques (Elektra, Die Frau ohne Schatten, Parsifal, Tristan und Isolde), Frank Beermann parvient, sans nuire jamais aux chanteurs solistes, à attribuer à l’orchestre la place de premier plan qui doit être la sienne. Le Wagner « en devenir » qui nous donnera plus tard le Ring ou Parsifal est déjà bien présent ici, mais il n’a pas oublié pour autant ce qu’il doit encore à Weber, voire à Meyerbeer.
PIERRE CADARS