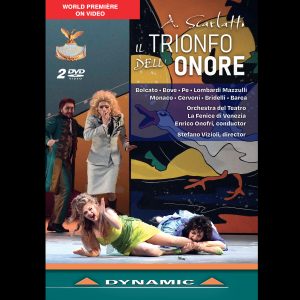Teatro Regio, 18 juin
Il est difficile de dissocier Andrea Chénier du contexte historique et sociopolitique dans lequel Giordano et Illica l’ont profondément enraciné. L’une des principales préoccupations du compositeur et de son librettiste fut en effet de restituer fidèlement le cadre d’époque dans ses moindres détails, à travers notamment des didascalies d’une précision inhabituelle. Dans cette perspective, les tentatives de transposition contemporaine s’avèrent souvent forcées ou peu convaincantes. Ce n’est pourtant pas le cas de la mise en scène signée Giancarlo del Monaco, déjà auteur auparavant de productions plus traditionnelles du chef-d’œuvre de Giordano. Dans cette nouvelle lecture, il construit une parabole visuelle à forte portée symbolique. Au fil des tableaux, la présence persistante de décombres sur l’avant-scène suggère les ruines – morales et matérielles – que toute révolution laisse derrière elle.
Le premier tableau prend place dans un XVIIIe siècle résolument maniériste, comme pour souligner la décadence imminente d’un Ancien Régime frivole et figé. Mais sa conclusion, avec l’irruption soudaine de soldats contemporains armés de fusils d’assaut, annonce un saut temporel de plus de deux siècles. Le deuxième se déroule sur l’esplanade d’une prison moderne et anonyme ; le buste de Marat gît dans la benne d’un camion militaire, signal clair que l’ère des idéaux a cédé la place à celle de la terreur. Le message est net : toute révolution est une utopie vouée à dériver en dystopie. Une vision pessimiste, discutable certes, mais non dénuée de force évocatrice, notamment dans certaines séquences d’une intensité saisissante – comme le troisième tableau, situé dans une vaste salle d’archives contemporaine, métaphore d’un contrôle bureaucratique omniprésent. C’est là que Maddalena entonne « La mamma morta », tandis que Gérard, face à un miroir, se lave compulsivement le visage, comme pour se purifier la conscience.
La direction d’acteurs s’avère cependant inégale, et le propos scénique peine parfois à maintenir une cohérence dramaturgique. S’y ajoutent pas moins de trois (!) entractes, qui brisent irrémédiablement le rythme narratif et étirent la soirée au-delà des trois heures et demie, affaiblissant son impact émotionnel.
Andrea Chénier est une partition plutôt complexe, scandée par une tension rythmique constante, des changements de pulsation soudains et des modulations fulgurantes. Elle exige une phalange souple et réactive, capable de soutenir sa tension dramatique. Andrea Battistoni – qui inaugurait ici son mandat de directeur musical du Teatro Regio – relève le défi avec énergie et dynamisme, tissant la richesse de la palette orchestrale en un discours théâtral palpitant, d’une remarquable force expressive. Sa lecture épouse la fluidité du récit, dont le moteur principal est une orchestration qui privilégie l’illustration directe de l’action au lieu de toute introspection psychologique. Le chef italien accompagne par ailleurs le chant avec une notable finesse, jouant habilement sur la dynamique et les jeux de clair-obscur et valorisant les élans lyriques sans jamais couvrir les voix.
L’infatigable Gregory Kunde (71 ans) étonne une fois de plus par l’aisance avec laquelle il surmonte les redoutables exigences du rôle-titre. Si le timbre porte naturellement les traces du temps, les aigus demeurent brillants et solides, et le phrasé conserve son articulation et son expressivité. Franco Vassallo, quant à lui, se plaît à mettre en valeur son timbre riche et sonore, mais son chant demeure souvent marqué par un goût interprétatif démodé et une technique perfectible : en résulte un chant uniforme et prévisible, incapable de rendre compte de la complexité du personnage.
Maria Agresta met sa voix souple et maîtrisée au service d’une incarnation exemplaire, atteignant le sommet de l’émotion dans une « Mamma morta » chantée dans une mezza voce finement nuancée, bien que le si naturel final y paraisse un peu contraint. Dans le duo final avec Chénier, sa Maddalena retrouve cependant tout le corps et le rayonnement de son aigu. Les seconds rôles sont globalement bien distribués ; on retiendra en particulier la bouleversante Madelon de Manuela Custer. Le chœur maison, comme toujours, s’illustre par son homogénéité et son engagement scénique.
PAOLO DI FELICE