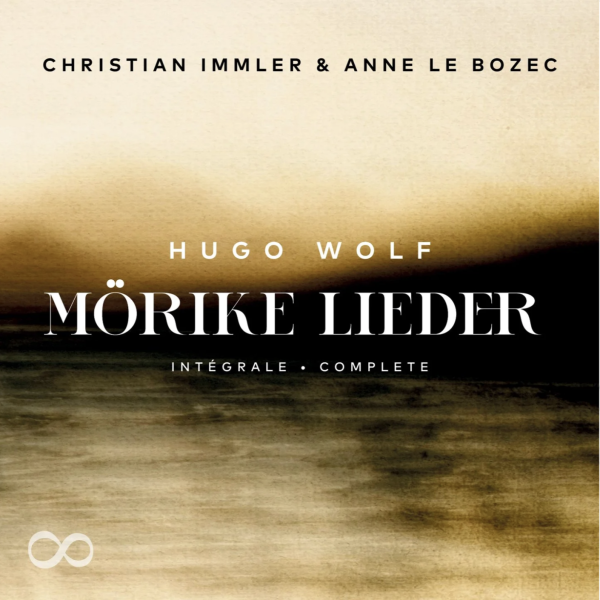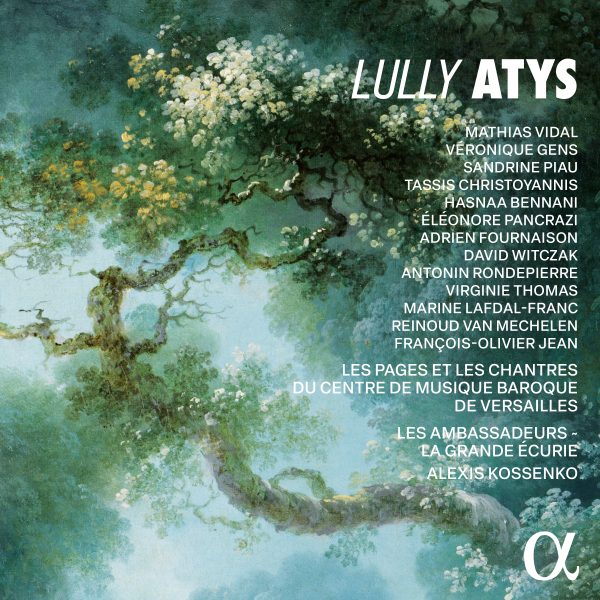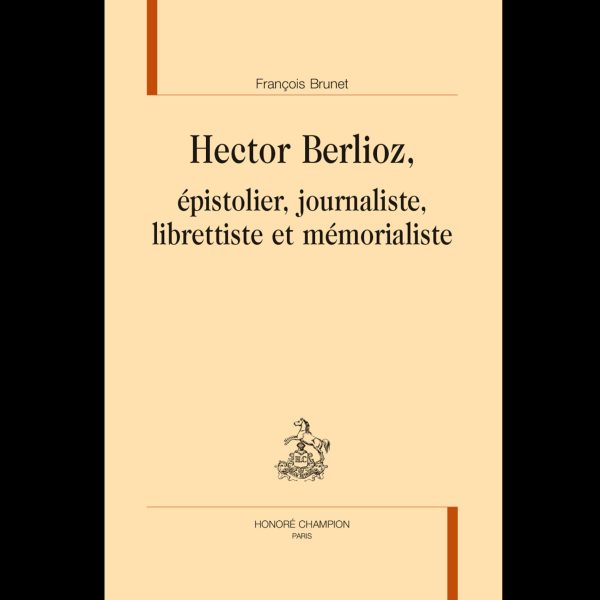Gerald Finley (Guillaume Tell) – John Osborn (Arnold Melcthal) – Alexander Vinogradov (Walter Furst) – Eric Halfvarson (Melcthal) – Sofia Fomina (Jemmy) – Nicolas Courjal (Gesler) – Michael Colvin (Rodolphe) – Enea Scala (Ruodi) – Samuel Dale Johnson (Leuthold) – Malin Byström (Mathilde) – Enkelejda Shkosa (Hedwige)
Royal Opera Chorus, Orchestra of the Royal Opera House, dir. Antonio Pappano. Mise en scène : Damiano Michieletto. Réalisation : Jonathan Haswell (16:9 ; stéréo : LPCM 2.0 ; DTS Digital Surround)
2 DVD Opus Arte OA 1205 D
Si l’on ne devait recommander qu’une seule version en DVD de Guillaume Tell, dans l’édition originale française, ce serait incontestablement celle filmée à Pesaro, en 2013 (Decca), couronnée d’un Diamant d’Opéra Magazine, vocalement idéale et sublimée par l’élégante vision historicisante de Graham Vick (voir O. M. n° 107 p. 80 de juin 2015).
Toutefois, la production très contestée de Damiano Michieletto, revue au prisme de son excellente captation, le 5 juillet 2015, au Covent Garden de Londres, ne manque pas d’intérêt, malgré quelques aspects un peu démonstratifs, que soulignait déjà Richard Martet dans son compte rendu du spectacle (voir O. M. n° 109 p. 56 de septembre 2015).
Le metteur en scène italien la construit selon deux axes : le premier est celui du rapport filial, incarné par le couple Melcthal/Arnold, et par celui que forme Tell avec son fils. Remettant au centre de l’action le personnage de Jemmy, incarné avec une vérité sidérante par la soprano russe Sofia Fomina, il en fait un adolescent hanté par la figure du Tell historique (omniprésent sur le plateau), projetant sur son père son désir d’héroïsme.
Le second axe est celui du peuple, et sa lutte contre l’oppression. À l’instar de Jochen Schönleber, à Bad Wildbad, Damiano Michieletto élimine toute référence à l’histoire helvétique, pour nous présenter une communauté contemporaine (migrants ou réfugiés d’un monde en guerre), privée de sa liberté et de son identité, en butte aux humiliations d’une soldatesque brutale, menée par le Gesler un rien forcé de Nicolas Courjal.
Le déracinement est symbolisé par un gigantesque arbre, couché en travers de la scène, où viennent se réfugier les bannis. Au final, il s’élève dans les cintres, tandis qu’un tout jeune enfant plante une pousse dans cette terre noire que brassent désespérément les personnages, tout au long de l’action.
L’ensemble offre une vision puissante, où l’intime et le domestique se mêlent à l’épique, qui culmine dans le finale du II, quand le chœur masculin entonne son serment torse nu, en se maculant de sang, en signe de l’acceptation du sacrifice à venir.
En accord avec cette vision sombre et grandiose, à laquelle la réalisation de Jonathan Haswell rend justice, Antonio Pappano offre une lecture très préromantique, avec un sens exemplaire de l’équilibre des masses sonores, des tempi lents et des phrasés souvent étirés.
Une certaine forme d’expressionnisme, imputable à une direction d’acteurs s’attachant à révéler le mal-être et l’angoisse des personnages, contamine un chant qui n’est déjà plus vraiment du bel canto. À part quelques accents légèrement exotiques – celui du Melcthal d’Eric Halfvarson, au vibrato un peu large, ou du Furst d’Alexander Vinogradov, à la basse néanmoins chaleureuse –, l’articulation du français, avec le concours des micros, se révèle plus qu’acceptable.
Le Tell de Gerald Finley n’est pas le héros de la tradition, mais un homme tourmenté, qui confère à son célèbre air du III une vérité psychologique bouleversante, et se révèle comme l’un des interprètes majeurs du rôle. John Osborn, ni ténor lyrique, ni baritenore, ne convainc pas complètement ; il ne donne la pleine mesure de ses moyens que dans la grande scène d’Arnold, au IV.
Le choix de Malin Byström répond à une conception passionnée et fébrile de Mathilde, mais sa voix lourde et régulièrement forcée n’est pas très agréable à l’oreille. Enkelejda Shkosa est une Hedwige touchante, et Enea Scala, un Ruodi un peu trop nasal.
Le chœur, enfin, s’affirme dans son extraordinaire cohésion comme le personnage majeur d’une ode à la liberté qui, dans cette production, va chercher le spectateur, non du côté de l’intellect, mais au plus profond de ses entrailles, dans le souvenir de luttes anciennes auxquelles elle redonne une étonnante actualité.
ALFRED CARON