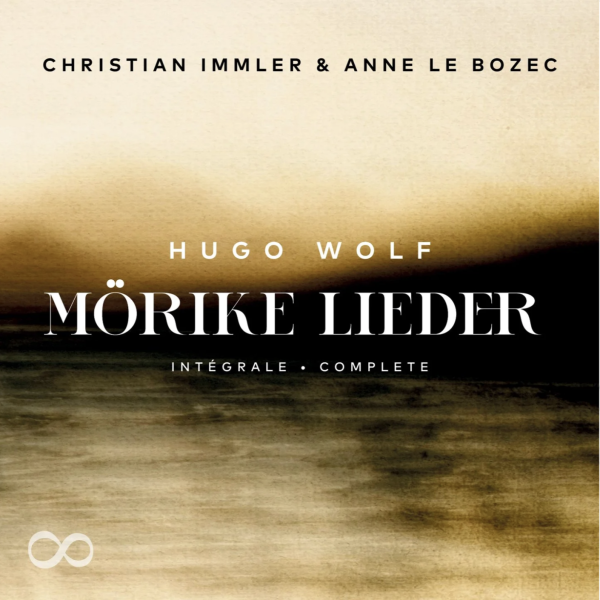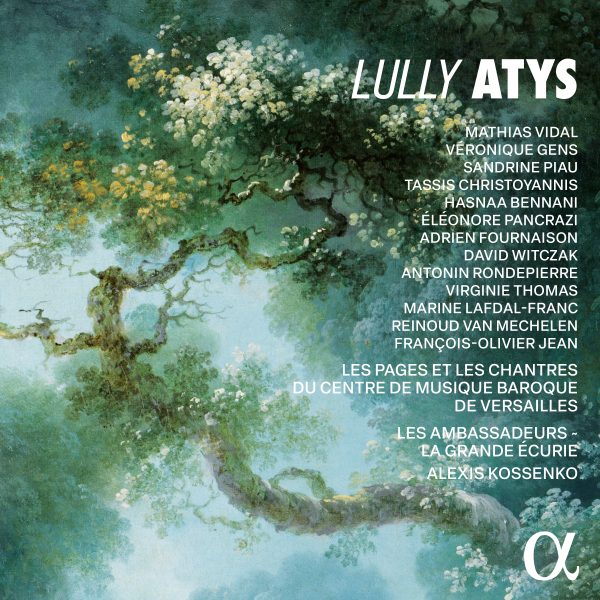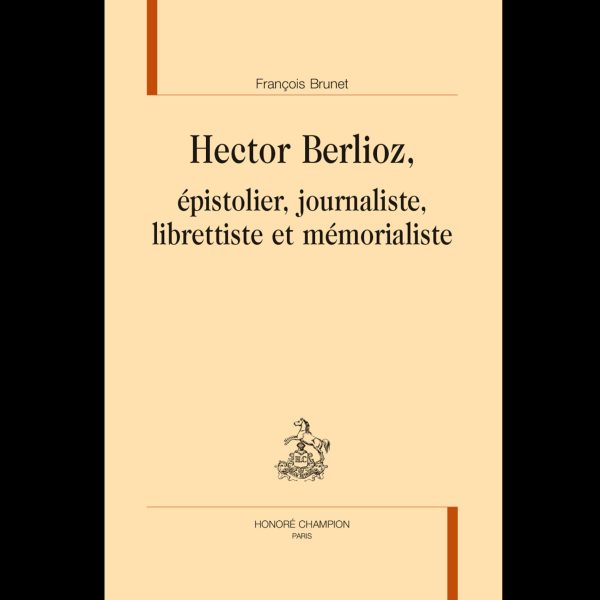La Messe solennelle, réputée perdue puis redécouverte par hasard, en 1991, a été gravée, deux ans plus tard, à cinq jours de distance, par Jean-Paul Penin puis par John Eliot Gardiner. Composée en 1824 par un Berlioz de 20 ans, alors élève de Lesueur (il ne s’inscrira au Conservatoire que deux ans plus tard), elle reste aujourd’hui une relative rareté, au concert comme au disque. Aussi se réjouit-on qu’Hervé Niquet l’ait inscrite au répertoire de son ensemble Le Concert Spirituel et l’ait fait entendre, en 2018, au Festival de La Côte-Saint-André, puis, en juin 2019, à Versailles, où elle a été enregistrée.
On sait combien le son roule dans nombre d’édifices religieux, mais l’écho de la Chapelle Royale, grâce à sa forme et à ses dimensions relativement réduites (nous ne sommes pas à Saint-Paul de Londres !), permet d’entendre et d’enregistrer très décemment la musique, qui nous arrive dans une prise de son très maîtrisée.
Hervé Niquet met beaucoup d’énergie à diriger cette Messe solennelle, et Le Concert Spirituel, la même énergie à l’interpréter, malgré un effectif relativement réduit : un chœur d’à peine quarante voix, un orchestre comprenant huit premiers violons, trois contrebasses, mais les quatre bassons requis, et le serpent et le buccin réclamés par Berlioz. Niquet va, en outre, plus loin que Gardiner en faisant prononcer le latin, par le chœur et les solistes, comme on le faisait à l’époque de Berlioz.
Rien, bien sûr, n’est laissé au hasard : ni la dynamique (le crescendo fiévreux à la fin du Kyrie), ni le sens du drame (il n’y a pas contraste plus violent que celui qui fait se télescoper l’Incarnatus et le Crucifixus), ni les choix musicologiques (Niquet fait entendre le Resurrexit original, avec un solo éprouvant pour la basse, passage qui sera ensuite confié au chœur dans la version révisée par Berlioz).
L’ensemble est pris dans des tempi allants (notamment le Gratias et le Crucifixus, seul le Kyrie adoptant un mouvement assez modéré), les nuances sont marquées, mais la nervosité n’exclut ni la clarté dans le tumulte (Resurrexit), ni l’interrogation devant le mystère (Crucifixus). Les chœurs forment une seule et même voix, et les cuivres sont d’une belle matière. On pourra seulement regretter que les trois solistes, il est vrai assez peu sollicités, ne soient pas davantage mis en valeur par la prise de son, et s’engagent d’ailleurs assez peu.
Seule Adriana Gonzalez exprime la tendresse requise dans l’Incarnatus, là où Julien Behr et Andreas Wolf, même dans le conquérant Domine salvum, se gardent de tout excès d’enthousiasme. Mais c’est là réserve mineure devant la fougue réglée qui mène cette interprétation, laquelle rivalise désormais avec celle de John Eliot Gardiner (Philips/Decca) et laisse loin derrière elle celle de Jean-Paul Penin (Accord), sur instruments modernes, et celle de J. Reilly Lewis (Koch), qu’on cite uniquement pour mémoire.
CHRISTIAN WASSELIN