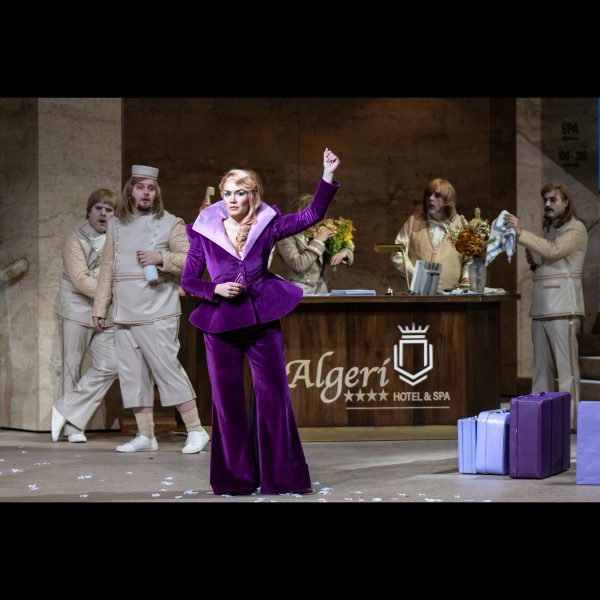Théâtre, 5 novembre
Grande interprète et créatrice de rôles marquants pendant sa longue carrière, Pauline Viardot fut aussi compositrice. On garde d’elle de nombreuses mélodies et quelques opéras de salon destinés pour la plupart à ses élèves et au cercle privé. Dans cette Cendrillon de 1904 dont elle est également l’autrice du livret, elle adapte habilement le conte de Perrault au prisme de certaines réminiscences d’opéras antérieurs – Isouard, Rossini et peut-être Massenet qui la précéda de quelques années. De la source française viennent bien sûr la citrouille et le rat, transformés en carrosse et cocher par la marraine fée – ici la tante – et la pantoufle de verre que seule Cendrillon peut enfiler ; de Rossini la chanson mélancolique de l’héroïne, le mendiant qui dissimule ici le prince et non le deus ex machina, et le prince déguisé en valet et réciproquement. Dans son livret, Viardot fait déjà preuve de beaucoup d’originalité. Elle ne se prive pas de quelques grivoiseries et de réflexions incongrues qui modernisent le conte. Ainsi du Prince qui propose aux deux sœurs de les emmener voir son « or au bout du corridor » ou de la chanson « de la rose », on ne peut plus explicite.
Pour cette adaptation, la co[opéra]rative a demandé à Jérémie Arcache d’orchestrer ce qui n’est au départ qu’une partition accompagnée au piano. Le résultat, avec quatre instrumentistes (piano, violoncelle, clarinette et percussions), nous emmène plutôt du côté de la comédie musicale à la Michel Legrand que de l’« opéra-comique », avec quelques excursus improvisés purement jazzy. Cet arrangement a l’avantage de créer une certaine continuité entre chant et parole, et bien qu’il soit un peu difficile de savoir ce qui dans le spectacle vient réellement de l’original et ce que l’on doit aux artisans de cette production, le sens mélodique de Pauline Viardot et ses qualités de compositrice y transparaissent, notamment dans le sextuor très élaboré au deuxième tableau. David Lescot a également adapté les dialogues dans un langage plus contemporain sans trop en trahir l’esprit, et sa mise en scène donne beaucoup de vigueur aux personnages, ajoutant çà et là quelques gags qui font mouche. Destinée à circuler, la judicieuse scénographie d’Alwyne de Dardel fait apparaître les instrumentistes dans le cadre doré de deux tableaux plongés dans un clair-obscur très XVIIe, et l’ensemble, y compris la belle cheminée de flammes, s’élève pour découvrir le podium qui figure le palais du Prince Charmant.
Dans le rôle-titre, Apolline Raï-Westphal fait valoir un agréable soprano lyrique léger et une incarnation pleine de délicatesse. Elle se lance, dans la scène du bal, dans une ébouriffante interprétation de l’étonnant Stripsody de Cathy Berberian, répondant au défi de ses deux sœurs, Clarisse Dalles et Romie Estèves, survoltées, qui se concurrencent dans un air de Don Giovanni où elles rivalisent de virtuosité et d’excentricité. La soprano colorature Lila Dufy donne une belle ampleur à la Fée, à qui la partition prévoit deux très beaux airs. Du côté masculin, les deux ténors qui se partagent les rôles du Prince et de son valet sont remarquablement différenciés, Tsanta Ratia avec un beau timbre lyrique central et Enguerrand de Hys à la voix plus grave. Olivier Naveau est un Baron de Pictordu languissant à souhait, dont le personnage d’épicier sorti de prison est sans doute le plus décalé imaginé par la compositrice. Tandis que le couple d’amoureux monte dans sa citrouille, dont Cendrillon a réclamé le volant, ajoutant, avec un brin d’humour, la petite touche féministe nécessaire, le public visiblement enchanté fait un beau succès à ce sympathique spectacle.
ALFRED CARON