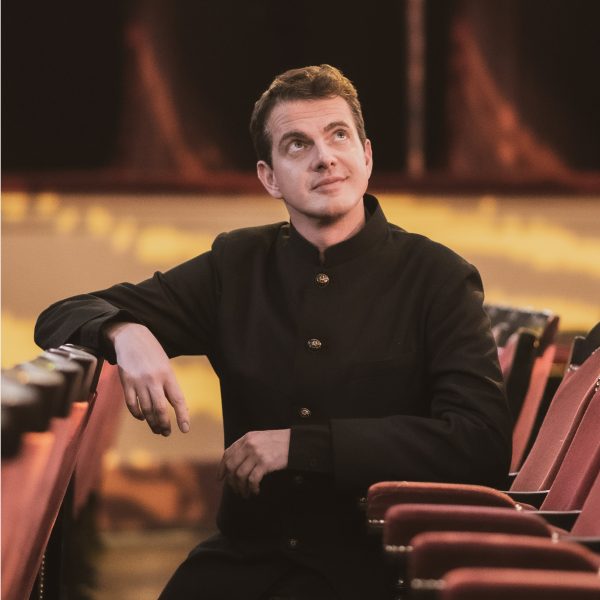Depuis ses débuts opératiques en Norma, à 29 ans, Saioa Hernández a vaillamment gravi les échelons du répertoire italien, la plaçant aujourd’hui en verdienne et vériste incontestée. La rentrée lui donne l’occasion d’incarner ces deux facettes à l’Opéra National de Paris, dans les rôles-titres d’Aida et de Tosca. Elle retrouve ainsi l’héroïne puccinienne qui lui a valu ses débuts à Bastille en 2022. La soprano madrilène a plus d’un tour dans son sac, et partage avec nous son aptitude à revenir aux fondamentaux et à explorer de nouvelles voies.
Après plusieurs années de prises de rôle, vous reprenez cette saison des personnages que vous connaissez bien – Aida et Tosca à Paris, La Gioconda à Barcelone, Lady Macbeth à Munich, Maddalena di Coigny (Andrea Chénier) à Bilbao, Leonora (Il trovatore) à Madrid…
Je crois que c’est nécessaire, car je me considère encore jeune chanteuse. En peu d’années de carrière, j’ai déjà interprété plus de quarante rôles. J’ai désormais besoin d’en approfondir certains. Plus jeune, je croyais que la première fois était nécessairement la meilleure, mais je me suis ensuite rendu compte qu’on ne pouvait pas se contenter d’une seule version d’un rôle. Il faut essayer de grandir avec, dans des mises en scène différentes, ou auxquelles on a déjà participé, en même temps qu’on acquiert de la maturité. Il est aussi important de toujours montrer au public que la musicalité n’est pas gravée dans le marbre. Je ne comprends pas qu’une chanteuse veuille toujours proposer la même Tosca, « sa » Tosca, d’une production à l’autre. J’aime être mise au défi sur ces rôles, surtout après avoir consacré autant de temps à les travailler. J’éprouve toujours plus de plaisir à les chanter, et je crois qu’ils ont beaucoup forgé ma vocalité et m’ont fait devenir l’artiste que je suis aujourd’hui. J’ai eu jusqu’à cinq prises de rôle par an ; dans un avenir très proche, j’en ai déjà d’autres en vue, mais à un rythme moins soutenu. Je n’ai pas pour objectif d’être la soprano qui détient le record des prises de rôle ! Nombreux sont ceux que je ne peux pas chanter aujourd’hui, mais je suis très contente d’en avoir autant à mon arc et d’aborder prochainement un répertoire tout autre.
De quel répertoire s’agit-il ?
Je ferai bientôt ma première incursion dans l’opéra allemand, avec Chrysothemis (Elektra). Il me semble essentiel d’être entourée d’une bonne équipe pour de bons débuts. Je ne veux pas juste faire mes débuts dans un rôle. J’ai souvent décliné des prises de rôle (même dans de grands théâtres), comme Lady Macbeth, Turandot, Santuzza (Cavalleria rusticana) et Minnie (La fanciulla del West), soit car ce n’était pas encore le moment pour moi, soit car ces propositions ne réunissaient pas des circonstances exceptionnelles : une production, un lieu, un chef particuliers. Mes débuts opératiques, en Norma, ont été permis par Carlos Caballé, et préparés avec Montserrat Caballé. C’était à Catane, sur la terre de Bellini, avec Gregory Kunde ! Pour Odabella (Attila), je chantais pour la première fois à la Scala, qui plus est en soirée d’ouverture de saison… Une folie et une merveille ! Mes débuts en Gioconda, à Plaisance, avec Francesco Meli, ont été diffusés en direct par la Rai. J’ai pu décider de chanter ma première Abigaille (Nabucco) à Dresde, ma première Turandot à Madrid, avec Nicola Luisotti, et ma première Lady Macbeth au Macerata Opera Festival, avec Francesco Ivan Ciampa. On ne peut pas toujours être maître de sa carrière, donc autant pouvoir « contrôler » certains paramètres. Pouvoir dire non aussi, car viendra toujours le moment juste.

Vous vous êtes initialement lancée dans des études de droit, mais vous avez spécifiquement fait le choix de la faculté pour son chœur, sans avoir une expérience préalable du chant. Aviez-vous l’intime conviction que la musique serait votre vocation ?
J’étais attirée par le droit, les sciences politiques, l’armée, la criminologie, la psychiatrie, et d’un autre côté, j’ai toujours aimé peindre, écrire, danser. J’étais à la recherche de quelque chose que je n’avais pas encore identifié, et je savais qu’une partie de moi avait un certain talent artistique sans trop savoir lequel, comme une intuition musicale. Quand j’étais seule à la maison, je mettais la minichaîne à fond sur Whitney Houston, Mariah Carey, Céline Dion ou Laura Pausini, et je m’enregistrais avec mon walkman. Je passais des heures à me réécouter pour imiter toutes leurs notes le plus fidèlement possible. À l’université, j’ai commencé à avoir des cours de chant individuels grâce au chœur, et à découvrir l’opéra. Puis, au début de ma vingtaine, ma mère a commencé à collectionner les opéras qui étaient offerts avec le journal. Je les écoutais avec elle en suivant le livret. Un jour, je l’ai accompagnée à un concours de chant. En entendant « Una voce poco fa », j’ai reconnu l’air d’un CD de Victoria de los Ángeles que nous avions à la maison, et que j’ai essayé de chanter le lendemain, avec mon baladeur. Un monde s’est ouvert à moi, avec une nouvelle technique, que ne permettait pas forcément la pop ou la soul. J’ai d’ailleurs eu un syndrome de l’imposteur quand j’ai commencé la musique. Je pensais arriver trop tard ou moins préparée que les autres. Il faut savoir valoriser ce qu’on sait faire, même quand on est très exigeant !
Comment créez-vous une connexion avec vos collègues sur scène ?
Au plateau, j’essaie toujours de développer une bonne ambiance qui puisse mettre en confiance mes collègues et instaurer une compréhension mutuelle. C’est l’une des choses les plus difficiles à réussir en tant qu’artiste, car on peut surtout avoir tendance à générer de l’insécurité. Avec de l’assurance, on peut se permettre d’expérimenter. Il arrive de trop penser à soi, et donc de trop s’accrocher à ce qu’on est, à ce qu’on sait, mais pour donner de l’assurance aux autres, on doit aussi être sûr de ce qu’on fait. Sur Il trovatore au Gran Teatre del Liceu en 2022, j’ai eu une pharyngite aiguë de la répétition générale jusqu’à la fin des huit représentations. J’étais aphone tous les matins, et j’allais au théâtre avec le directeur artistique sept heures avant la représentation, pour prendre le temps de flexibiliser ma voix. À partir du moment où l’on accepte qu’on n’est pas dans une forme olympique et qu’on décide de chanter parce qu’on s’en sent capable, les pensées négatives et le « drama » doivent cesser. Le corps et les muscles savent ce qu’ils doivent faire, et la technique apporte aussi une sécurité. Nous avons également tendance à sous-estimer l’adrénaline du moment, qui nous garantit 40 % du résultat final. Avec de la positivité, les choses se passent bien, et même bien mieux que ce que l’on croit. Cela demande beaucoup de sang-froid !
Vous parlez souvent d’« interprétation » plutôt que de chant. Interpréter, est-ce s’engager émotionnellement ou se laisser porter par le chant et le contexte musical ?
Quand, adolescente, je chantais, je ne m’imaginais pas que l’interprétation, le théâtre et le travail en équipe seraient ce qui me plairait le plus dans ce métier. La partie vocale doit toutefois être bien « résolue », avant toute chose. Nous n’avons pas tous la même technique ; il n’y en a pas une bonne et une mauvaise. Chacun suit son chemin. En montant sur scène, on ne cherche qu’à donner le meilleur, et les répétitions sont selon moi primordiales – alors qu’il y en a hélas de moins en moins – pour consolider la partie musicale. Je préfère que les répétitions musicales arrivent après les scéniques, où les chefs d’orchestre devraient idéalement être présents. Je pose souvent beaucoup de questions, pour qu’un sens musical et une harmonie scénique s’offrent à moi. Et si cela n’a pas de sens pour moi, cela n’en aura pas pour le spectateur. Cela n’a rien à voir avec le fait qu’une mise en scène soit moderne ou non. Une mise en scène est intelligente ou non, bien faite ou mal faite. Musicalement, c’est pareil. Une production ne fonctionne que quand les deux pans fusionnent. Il faut d’abord saisir la motivation de chaque mouvement scénique et de chaque phrase musicale pour ensuite laisser la place à l’intuition et développer les émotions du personnage.
C’est là qu’intervient votre propre interprétation…
N’oublions pas que nous sommes seulement des interprètes. Nous ne sommes des créateurs que par le fait de générer de l’art à travers l’œuvre de quelqu’un d’autre. Dans l’interprétation d’un rôle entre évidemment en compte la personnalité artistique de chacun sur la production, jusqu’aux costumiers et aux perruquiers. La magie de cette interprétation s’explique aussi par la nature non routinière de notre vie, où aucune journée ne se ressemble, même psychologiquement. Si je fais un contre-mi bémol à la fin de l’acte II d’Aida, ce n’est pas parce que je l’ai décidé le matin même, mais parce que je sens, sur le moment, qu’il vient. Quand je sais que je vais beaucoup chanter un rôle, j’aime voir comment ma voix réagit aux propositions nouvelles qu’on me fait. Être mal à l’aise est peut-être simplement le signe qu’on s’accommode à ce qu’on a toujours fait. Nous devons être prêts à sortir de notre zone de confort pour que le public voie à chaque fois d’autres versions de nous-mêmes. Il m’est même arrivé de garder sur d’autres productions des choses qui, au départ, me paraissaient inconfortables. Joan Matabosch, le directeur artistique du Teatro Real, dit toujours que l’opéra n’est pas un musée. On ne vient pas voir un tableau toujours identique. L’opéra ne doit pas non plus être un simple divertissement pop-corn, c’est de l’art, vivant, et un art qui en implique beaucoup d’autres.

Quelle typologie de personnages préférez-vous ?
J’adore jouer les méchantes, sadiques et ironiques, peut-être parce que je ne suis pas comme cela dans la vraie vie. Abigaille, comme Turandot (dans le finale d’Alfano), se rachète. Trouver des contrastes, dévoiler une partie de soi-même, puis prendre la direction opposée, me plaît beaucoup. Il y a toutefois des rôles auxquels on s’identifie plus ou moins. J’ai par exemple plus de mal à interpréter les rôles statiques, c’est-à-dire ceux qui se maintiennent dans une même ligne de conduite, comme Leonora dans Il trovatore. Elle est très lunaire, il lui manque des aspérités, même si avec le temps, je lui voue toute l’affection du monde ; c’est un rôle que j’adore chanter et que j’ai réussi à m’approprier, notamment grâce à cette musique inoubliable. Mais il est vrai qu’il existe des personnages plus complexes, à l’évolution plus claire, qui permettent de jouer et d’explorer davantage. Si Aida n’a pas autant de facettes que Lady Macbeth, elle en a tout de même davantage que Leonora, d’autant que le rôle donne le temps de développer une dramaturgie, au-delà du chant. Tosca est quant à elle un bijou à interpréter, avec ses milliers de caractères. C’est dans ce type de rôle que je prends le plus de plaisir à jouer sur scène.
Vous avez une technique belcantiste, mais chantez aujourd’hui surtout du post-bel canto, du Verdi, du Puccini… Quelles sont les limites de cette technique pour les rôles plus dramatiques du répertoire ?
Je vois les choses plutôt dans l’autre sens. Plus qu’une limite, la technique du bel canto est pour moi le grand point de départ de tout l’opéra italien, mais aussi d’autres répertoires. Étudier Mozart avant le bel canto, dans les conservatoires, est, selon moi, une erreur. Une technique belcantiste solide permet d’affronter le reste du répertoire avec un chant toujours concentré sur le souffle, placé haut dans le masque, et connecté à la poitrine. Le bel canto explore l’ensemble de l’expressivité, dans toutes les tessitures, avec une liberté de la voix. Quand on interprète Mozart en ayant chanté du bel canto au préalable, on comprend mieux le récitatif mozartien, vers où va la phrase, c’est plus riche vocalement. Mais si on commence à chanter en gardant en permanence la constance du son, il devient très difficile de se défaire de cette approche. Mozart est plus facile à lire et à affronter ; cela ne veut pas dire qu’il soit plus facile à chanter – surtout en début de carrière – et surtout à bien chanter. Un chanteur à l’aise avec le bel canto peut ensuite affronter le romantisme, le postromantisme et le vérisme de façon bien plus saine, au contraire d’un chanteur qui n’aurait fait que du vérisme, et qui voudrait aller vers le bel canto.

Avez-vous justement des projets belcantistes ?
Je ne considère pas Il trovatore et Nabucco en dehors de la ligne du bel canto. Pour moi, le son doit toujours être beau, le plus riche et pur possible, sans artifice, y compris dans le parlato et le sul fiato, bien connecté à la tête et à la poitrine. Il faut rendre la voix flexible dans cet équilibre. Je pourrais revenir sans problème à Gilda (Rigoletto), Mathilde (Guillaume Tell), et Lucia di Lammermoor, bien qu’évidemment, en ce moment, personne ne pense vraiment à moi pour Lucia. Je ne rechanterai sans doute plus Violetta (La traviata), mais j’aimerais bien reprendre Norma et Imogene (Il pirata), des rôles dramatiques d’agilité. Je trouve finalement Norma et Abigaille assez similaires. Et j’aimerais beaucoup chanter Anna Bolena, Elisabetta de Roberto Devereux et Lucrezia Borgia chez Donizetti, et Elisabetta-Élisabeth dans Don Carlo(s) de Verdi. J’avais dû annuler mes débuts prévus dans Les Vêpres siciliennes en 2022 au Deutsche Oper de Berlin avant de commencer les répétitions, pour des raisons de santé. Mes prises de rôle d’Amelia Grimaldi (Simon Boccanegra) et de Giselda (I Lombardi alla prima crociata) ont été annulées à cause de la pandémie, mais je les garde dans un coin, presque prêtes. Desdemona (Otello de Verdi) ne m’attire pas énormément – je disais la même chose de Turandot, que j’adore maintenant chanter – mais si on me la proposait, je l’accepterais sûrement !
THIBAULT VICQ
.