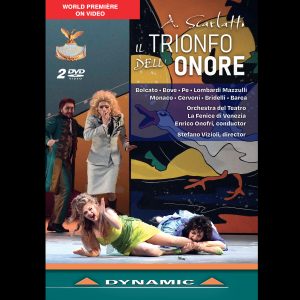Teatro alla Scala, 27 juin
Aussi étrange que cela puisse paraître, Norma n’avait plus été donnée à la Scala depuis près d’un demi-siècle. Les plus anciens mélomanes se souviennent de la dernière production avec Montserrat Caballé en 1977… mais c’est bien Maria Callas, dans les années 1950, qui avait scellé l’union mythique entre la druidesse bellinienne et le théâtre milanais. C’est ici-même que l’œuvre fut créée, le 26 décembre 1831, dans une ville encore sous domination autrichienne, secouée par les premiers remous révolutionnaires.
Un double héritage – musical et politique – qu’Olivier Py entend convoquer dans cette nouvelle mise en scène, au risque d’une lecture un brin didactique, voire manichéenne, du Risorgimento : d’un côté, les soldats de l’Empire en uniformes blancs, bannières sable et or, aigle bicéphale en étendard ; de l’autre, une bourgeoisie milanaise en ébullition patriotique, brandissant le tricolore comme un symbole sacré. À la place des druides, une élite nationaliste menée par Oroveso, avec Norma en égérie, partagée entre mission publique et amour interdit. Une idée séduisante, qui pourrait se suffire à elle seule. Mais Olivier Py pousse le curseur plus loin : à cette transposition historique s’ajoute une mise en abyme, où Norma devient une actrice star, appelée à jouer – sur la scène même de la Scala – le rôle de Médée, archétype dont elle apparaît comme l’héritière moderne.
Le plateau ne cesse de tourner, dévoilant tour à tour façade, plateau, coulisses et machinerie de ce théâtre dans le théâtre. Par sa structure en blocs, le chef-d’œuvre de Bellini se prête à ces allers-retours entre niveaux complémentaires. Une mécanique visuelle spectaculaire, mais qui finit par brouiller la lisibilité, notamment au II. À force de multiplier les niveaux de lecture, l’ambition dramaturgique dilue la tension intime du drame. Certes, Olivier Py sait ménager des tableaux saisissants – la prière, au I, baignée d’une lumière extatique, ou l’appel à la guerre, au II, avec chœurs et figurants massés derrière un rideau de flammes. Mais la dynamique repose trop souvent sur l’accumulation d’éléments extérieurs. L’abîme psychologique des personnages s’en trouve relégué au second plan. Sur un plateau généralement encombré, la tournette finit par lasser, et les chorégraphies de danseurs torse nu peinent à s’intégrer au récit. Quant au finale – Norma et Pollione fusillés plutôt que livrés au bûcher –, il achève l’irritation d’une partie du public, qui réserve au metteur en scène une salve de huées aux saluts.
Le bilan musical se révèle moins contrasté. À la direction de Fabio Luisi, élégante et mesurée, ne manque qu’un supplément d’abandon pour émouvoir, à la tête d’un orchestre maison que l’on connaît plus subtil dans les textures et les nuances. Entourée d’un chœur idéal d’engagement et de cohésion, la distribution séduit davantage par la splendeur vocale que par la profondeur des incarnations.
Si Michele Pertusi (Oroveso) impose son autorité habituelle, Marina Rebeka, familière du rôle-titre depuis une décennie et protagoniste d’une version discographique de référence, paraît ici curieusement retenue, notamment dans « Casta Diva » (dans la version traditionnelle en fa), où le registre central sonne un peu artificiel, au détriment de l’aura mystique attendue. Mais dès la première cabalette (« Ah! Bello a me ritorna »), la soprano lettone déploie sa panoplie belcantiste, coulée dans un timbre ambré, au grain nourri et tranchant. Hiératique, presque marmoréenne, sa Norma n’en demeure pas moins traversée par des élans de tendresse ou de sensualité. C’est toutefois dans le finale (« Qual cor tradisti ») que s’épanouit l’âme tragique de l’héroïne : un sommet de beauté musicale et de vérité dramatique.
Face à elle, Freddie De Tommaso campe un Pollione à la vocalité résolument rétro, qui n’est pas sans évoquer un Del Monaco : timbre viril, émission vaillante, ligne conquérante, davantage ténor héroïque que « baryténor » néobelcantiste. Mais c’est du coté d’Adalgisa que vient la révélation : voix somptueuse, ample et homogène, diction limpide, palette expressive d’une rare finesse, Vasilisa Berzhanskaya incarne à fleur de peau le moindre mot de la jeune prêtresse, faisant de chaque duo avec la protagoniste une confrontation d’égale à égale, dans une touchante complémentarité. Nul doute qu’avec une direction musicale plus habitée et un jeu dramatique plus fouillé, elles auraient provoqué ces larmes et ces frissons dont Bellini détient le secret.
PAOLO PIRO