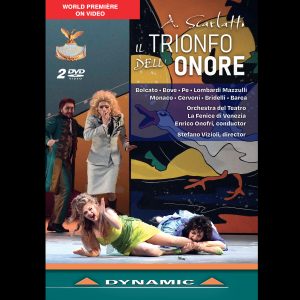Opéra, 15 mars
En 2012, dans une usine de lingerie de la Haute-Loire, onze travailleuses durent gérer un dilemme face à la menace d’un plan social : sacrifier ou non la moitié de leurs quatorze minutes de pause pour que leur atelier ne procède à aucun licenciement. Ce fait réel, l’écrivain Stefano Massini en fait une pièce de théâtre rapidement portée à l’écran. Ces 7 minuti fournissent la matière à un livret en italien du compositeur Giorgio Battistelli lui-même, pour une création à Nancy (voir O. M. n° 148 p. 51 de mars 2019). Christian Wasselin rendait compte avec enthousiasme, passée la crainte d’un « pensum réaliste-socialiste », du spectacle présenté dans une mise en scène de Michel Didym. Fait assez rare pour être souligné, pour ce retour de l’ouvrage à la scène si peu de temps après la création, l’Opéra de Lyon choisit de proposer une nouvelle mise en scène et une équipe musicale entièrement renouvelée, pour le troisième et dernier volet de son festival.
Si la scénographie de Nancy montrait une salle de détente impersonnelle, bien qu’assez chaleureuse, la production lyonnaise due à Pauline Bayle se déroule dans un atelier souterrain éclairé au tube fluorescent où atterrissent des chutes de tissu à balayer constamment, symbole d’un process ne devant jamais s’interrompre pour être viable. Pendant l’installation du public, les portraits vivants projetés sur le rideau de scène des ouvrières et employées, filmées en gros plan et en noir et blanc, tentent d’imprimer dans la rétine le visage de ces femmes dont les emplois vont être menacés pendant les deux heures sans pause de la représentation, dans un suffocant huis clos.
Ce travail scénique, qui caractérise au mieux chaque personnage, réserve quelques moments saisissants, comme ces croix dessinées au mur validant les dix votes initiaux en faveur d’un abandon de la moitié de la durée de pause qui, au retour des projections des portraits, couvrent exactement la bouche des intéressées. Comme si les ouvrières ne pouvaient que se taire devant l’évidence du presque rien consenti des quelques minutes à sacrifier. Il faudra toute la détermination de Blanche, la déléguée du groupe, pour retourner petit à petit le vote de ses collègues en une sorte de « Onze femmes en colère », écho à l’acquittement final, au cinéma, de l’adolescent initialement promis à la peine capitale dans Douze hommes en colère de Sidney Lumet (1957).
L’écriture orchestrale, quelque part entre le Berg de Lulu et la matière du Prigioniero de Dallapiccola, ne manque pour pleinement convaincre que de contrastes plus marqués dans son continuum sonore sempre moderato, accentué par la direction de Miguel Pérez Iñesta. Il n’est guère que l’épisode des accusations de racisme où le discours devient vraiment haletant, à même de transcender la dramaturgie du juste milieu qui tient lieu de colonne vertébrale à l’opéra.
L’écriture vocale se déploie sur tout le spectre de la voix féminine, avec un art remarquable de la déclamation. Et si Lyon a misé sur une distribution moins authentiquement transalpine que Nancy, les incarnations sont de tout premier ordre, à commencer par la Blanche au contralto très corsé, à la vraie force de persuasion, de Natascha Petrinsky, formant un contraste parfait avec la Sophie à la colorature funambule d’Elisabeth Boudreault. Par ailleurs, en ce soir de première, Shakèd Bar, Rachel aphone, est doublée en bord de scène, partition en main, par la voix radieuse d’Eleonora Vacchi, créatrice du rôle en Lorraine il y a six ans.
YANNICK MILLON