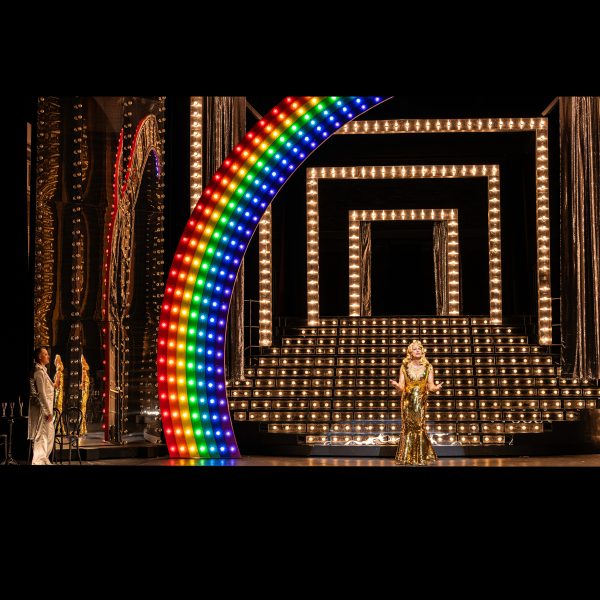Théâtre Copeau, 7 novembre
De nombreuses compositrices étant récemment ressorties d’un oubli plus ou moins justifié, la résurrection de Louise Bertin (1805-1877) était une évidence. Nous avons, en effet, affaire, avec elle, à une personnalité particulièrement intéressante. Sa situation privilégiée de fille du puissant directeur du Journal des débats, soutien du gouvernement, lui aura, sans doute, nui. Car comment expliquer autrement que par la malveillance politique l’échec de La Esmeralda, créée à l’Académie Royale de Musique de Paris (Salle Le Peletier), le 14 novembre 1836, presque neuf mois après Les Huguenots ?
Adaptant pour l’occasion son récent roman Notre-Dame de Paris (1831), Victor Hugo, ami de la famille Bertin, met prudemment ses pas dans ceux d’Eugène Scribe, en le rendant conforme aux exigences d’un livret d’opéra. Autant dire, tout de suite, que le grand homme se trahit lui-même. Quasimodo passe au second plan, l’essentiel du drame se jouant entre Esmeralda, le sombre Frollo et l’aimable Phœbus, réduit ici au rôle de galant amoureux.
Depuis les six représentations de 1836, La Esmeralda aura été reprise à Besançon, en 2002, puis à Paris, en 2007, dans l’édition chant-piano de Liszt, mais surtout, l’année suivante, avec orchestre, à Montpellier, pour un concert, dirigé par Lawrence Foster, dont l’enregistrement a été publié chez Accord (voir O. M. n° 43 p. 83 de septembre 2009). Bien que l’ouvrage ne soit donc pas tout à fait inconnu, on se disait que l’on allait assister, avec bonheur, à sa première version scénique moderne. Or, pas du tout !
Car cette coproduction entre l’Opéra de Saint-Étienne, le Théâtre des Bouffes-du-Nord, l’Opéra Grand Avignon, l’Opéra de Tours, l’Opéra de Vichy, le Théâtre de Cornouaille-Scène Nationale de Quimper et le Centre d’Art et de Culture de Meudon repose sur un malentendu. Elle se présente, en effet, sous la forme d’une réduction a minima de l’opéra.
Cinq rôles (sur treize) ont été conservés, dont un, celui de Clopin, quasiment parlé. Et tandis que les principaux numéros subsistent, sur un accompagnement bien malingre, les récitatifs sont modifiés, parfois chantés a cappella, parfois déclamés. Les nombreux chœurs sont absents – ou enregistrés, quand ils ne sont pas braillés par les musiciens, au nombre de cinq également, dans l’arrangement de Benjamin d’Anfray, qui dirige, du piano, l’ensemble Lélio. Et il n’est, bien sûr, pas question de l’opulente décoration qui faisait tout le prix des « grands opéras », à l’époque de leur création.
Ici, des praticables et tubulures, un pilier gothique et une rosace évoquent le chantier actuel de Notre-Dame. Des choix assumés par Jeanne Desoubeaux, qui a souhaité resserrer la mise en scène autour des pages essentielles, en tirant la pièce vers la question, si brûlante, des violences faites aux femmes, et en faisant « circuler l’énergie des corps en scène et la bestialité des rapports hommes-femmes ».
Malheureusement, il ne reste, chez les personnages mythiques imaginés par Victor Hugo, rien de franchement « bestial », ni dans la musique, ni dans le texte – ce qui rend assez décalée une scène érotique un peu lourde, d’autant plus inattendue qu’une telle ardeur n’était pas spécialement évoquée dans le livret.
Ajoutons que la représentation commence par un bon quart d’heure d’une sorte de rave party gothique, sur une bruyante musique techno. Et que le dénouement diffère absolument du finale de l’opéra : alors que Phœbus, blessé, est censé venir mourir aux pieds de l’héroïne, en dénonçant Frollo, Esmeralda est, ici, brûlée vive.
Et puis, et c’est là l’essentiel, si l’on se rappelle que l’ouvrage fut créé par un quatuor mythique – Cornélie Falcon (La Esmeralda), Adolphe Nourrit (Phœbus), Nicolas-Prosper Levasseur (Frollo), Eugène Massol (Quasimodo) –, Jeanne Mendoche, Martial Pauliat, Renaud Delaigue et Christophe Crapez en sont bien loin, dont les qualités vocales et scéniques ne compensent pas les failles techniques importantes.
Bien qu’il se tienne du point de vue de la narration globale et de la direction d’acteurs, le spectacle ne rend, dès lors, pas justice à un opéra romantique injustement négligé.
JACQUES BONNAURE