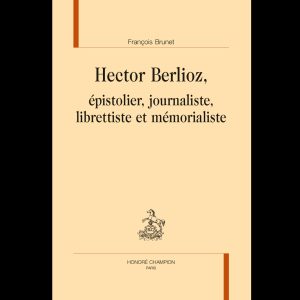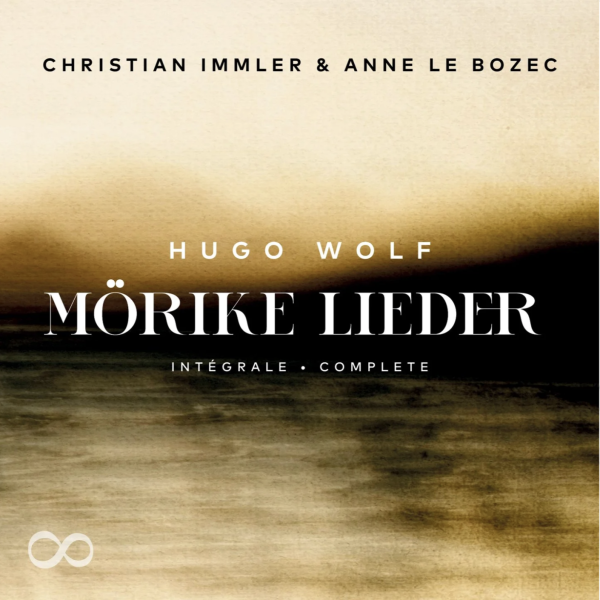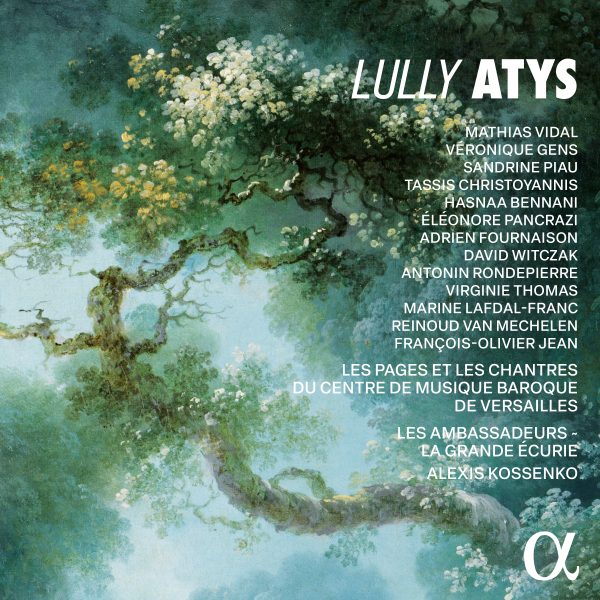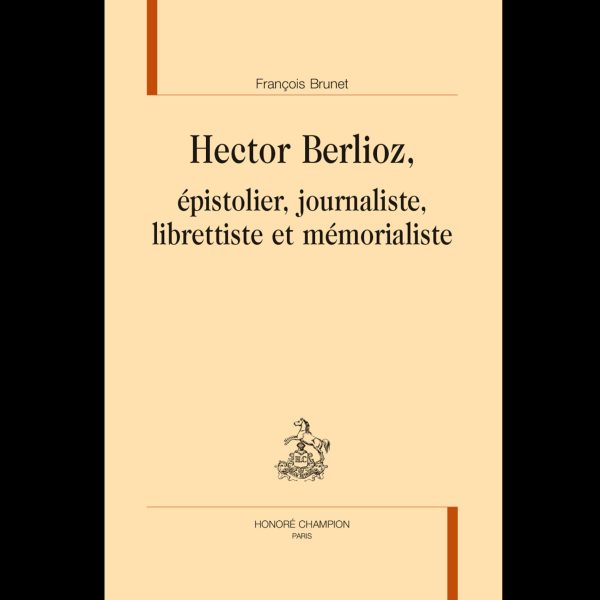L’equivoco stravagante, premier grand « dramma giocoso » de Rossini, créé à Bologne, en 1811, reste l’un de ses moins connus. Ses deux actes portent, pourtant, en germe le meilleur de ses comédies à venir.
Banni des scènes italiennes par la censure pour cause d’obscénité, il met en scène un bas-bleu naïf, Ernestina, en butte aux assauts d’un amoureux sincère (Ermanno) et d’un séducteur intéressé (Buralicchio). Jouant en permanence des doubles sens d’un langage littéraire amphigourique – un peu l’équivalent italien de celui des Précieuses ridicules de Molière –, le livret de Gaetano Gasbarri est effectivement riche en allusions sexuelles. De plus, pour éviter le mariage arrangé d’Ernestina, Frontino, son serviteur zélé, ne trouve rien de mieux que de la faire passer pour un castrat, déguisé en femme, afin d’échapper au service militaire, ouvrant la voie à des situations pour le moins scabreuses – dont un duo ébouriffant entre le pseudo-castrat et son prétendant terrifié !
La production filmée à Bad Wildbad, en juillet 2018 (voir O. M. n° 143 p. 30 d’octobre), tire tout le parti possible de ces ambiguïtés et de cette confusion des genres. Avec des moyens d’une totale économie – de simples panneaux mobiles, un canapé et quelques poufs, de subtils éclairages, des costumes inventifs très « seventies », où les perruques jouent la carte de l’unisexe –, Jochen Schönleber met en scène cette comédie des erreurs, avec une invention théâtrale centrée sur la caractérisation des personnages.
La distribution, impeccable jusqu’au plus petit rôle, se prête au jeu avec un bonheur communicatif. On savoure l’amoureux transi de Patrick Kabongo, l’écriture d’Ermanno mettant en valeur son beau ténor lyrique, son phrasé élégant et son timbre épanoui. Le mezzo-contralto, aux graves profonds, d’Antonella Colaianni se métamorphose, avec brio, d’oie blanche garçonnière en séductrice, ne faisant qu’une bouchée de l’exigeant air serio écrit pour la légendaire Marietta Marcolini.
Excellent, le Buralicchio du baryton Emmanuel Franco, play-boy ridicule, et plus grand que nature, en parvenu auto-satisfait, le Gamberotto de Giulio Mastrototaro, à la basse stentorienne. La Rosalia de la soprano Eleonora Bellocci forme, enfin, avec le Frontino du ténor léger Sebastian Monti, un couple de serviteurs délurés particulièrement réussi.
Le chœur masculin, incarnant tour à tour les paysans de Gamberotto, les amis lettrés d’Ernestina et les soldats des dernières scènes, est absolument irrésistible, affublé de kilts et de perruques burlesques. En fosse, José Miguel Pérez-Sierra révèle toute la richesse d’une partition dont Rossini réutilisera, plus tard, les meilleures pages, après l’interdiction de représentation de l’ouvrage, les récitatifs, accompagnés de façon très vivante par Michele D’Elia, contribuant à la fluidité de l’action.
Moins sophistiquée que la production d’Emilio Sagi, filmée au « Rossini Opera Festival » de Pesaro, en 2008 (DVD Dynamic), mais plus directe et bien plus drôle, cette réalisation devrait permettre à ceux qui ne le connaissent pas encore de découvrir les merveilles musicales de ce petit chef-d’œuvre.
Un regret, toutefois : l’absence de sous-titres français, qui réserve la compréhension des subtilités du texte aux seuls familiers de la langue italienne. Heureusement, la finesse de la mise en scène et la réussite d’ensemble compensent largement.
ALFRED CARON