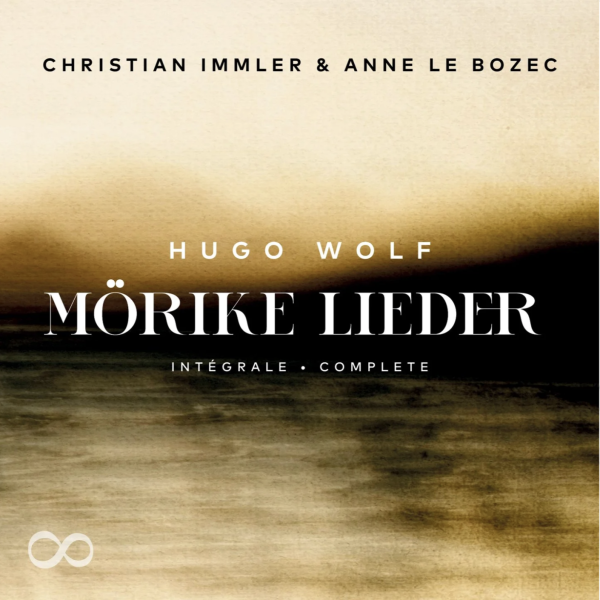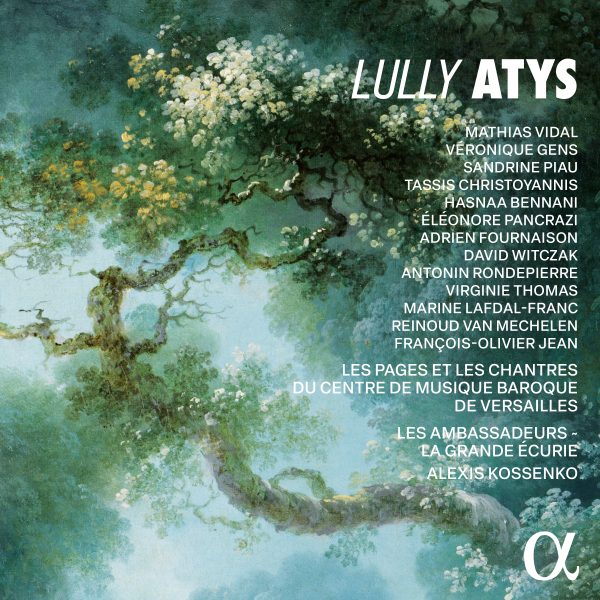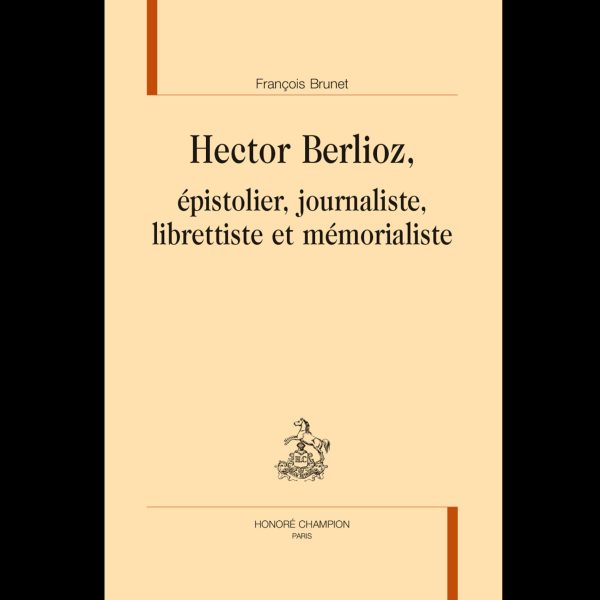Nina Stemme (Turandot) – Carlo Bosi (Altoum) – Alexander Tsymbalyuk (Timur) – Aleksandrs Antonenko (Calaf) – Maria Agresta (Liù) – Angelo Veccia (Ping) – Roberto Covatta (Pang) – Blagoj Nacoski (Pong) – Gianluca Breda (Un mandarino) Orchestra e Coro del Teatro alla Scala, dir. Riccardo Chailly. Mise en scène : Nikolaus Lehnhoff. Réalisation : Patrizia Carmine (16:9 ; stéréo : LPCM ; DTS Digital 5.1 Surround)
1 DVD Decca 074 3937
Sans se hisser au rang de référence, certains enregistrements, audio ou vidéo, se révèlent indispensables. Cette captation de la première de la production de Turandot qui inaugurait, le 1er mai 2015, la programmation de la Scala pour l’Exposition universelle, est de ceux-là.
Un Mandarin indigne et des Ministres au petit pied – même si le Ping d’Angelo Veccia s’affirme au fil des actes – ne sauraient faire pencher la balance en défaveur de la distribution. D’autant que Carlo Bosi se distingue des ténors cacochymes qui tirent, depuis bien trop longtemps, Altoum vers la caricature.
Si sa basse manque de creux et de maturité, Alexander Tsymbalyuk est un Timur superbement phonogénique. Et Maria Agresta, dont Liù semble d’abord légèrement excéder les moyens, touche au sublime à l’heure de sa mort, par l’alliage frémissant, et jamais démonstratif, entre lumière – ces notes suspendues comme en apesanteur – et fragilité.
Sans doute le bronze d’Aleksandrs Antonenko, dont l’aigu, au vibrato trop généreux, manque parfois de liberté, est-il plus uniformément robuste que princier – quoiqu’il ne néglige ni la ligne, ni la diction. Mais son Calaf ne connaît aujourd’hui aucun rival, en termes de format et d’impact vocal.
Quant à Nina Stemme, comme nous l’avions écrit dans notre compte rendu d’une représentation ultérieure (voir O. M. n° 108 p. 59 de juillet-août 2015), elle rayonne, immense Turandot, dans la lignée de Birgit Nilsson. Tranchante donc, et cependant moins impavide que sa glorieuse aînée, grâce à cette chair magmatique, et d’une égalité quasi surnaturelle sur tout l’ambitus, qui, sans faire d’emblée fondre la glace, laisse entrevoir, en dépit d’un costume encombrant, et même assez ridicule, la fêlure de la princesse.
Nikolaus Lehnhoff, que l’on découvre, non sans émotion, très amaigri au rideau final, quelques mois avant sa disparition, ne l’exploite guère, dont la mise en scène s’en tient, par-delà la stylisation des décors de Raimund Bauer, aux poses fixées par la tradition. Mieux vaut, pourtant, cet esthétisme souvent glaçant plutôt que les délires visuels, façon quincaillerie de luxe, auxquels a donné lieu la Chine légendaire du livret d’Adami et Simoni.
Les timbres de l’orchestre de Puccini – puis de celui de Luciano Berio, durant les quinze minutes d’un finale que Milan entendait pour la première fois – suffisent à l’évoquer, avec un raffinement que la baguette de Riccardo Chailly transcende avec un sens quasi cinématographique de la narration.
Pour le rôle-titre et le chef, un DVD à marquer d’une pierre blanche.
MEHDI MAHDAVI