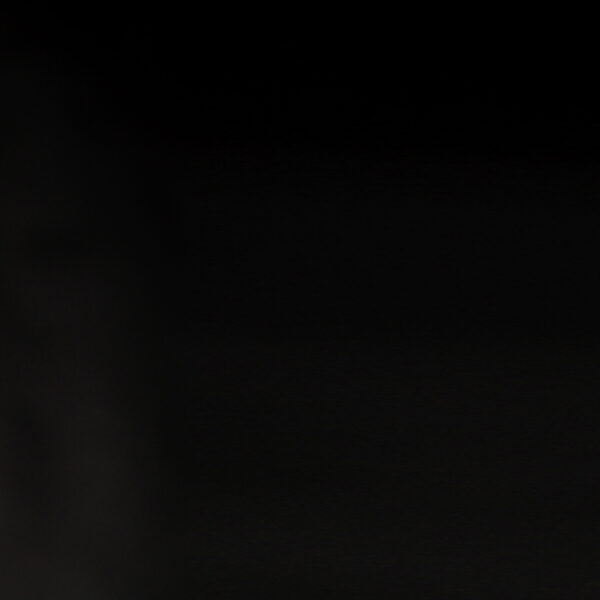Grosse actualité discographique pour le jeune chef français et son ensemble Pygmalion, chez Harmonia Mundi. Après le CD Stravaganza d’amore !, autour de la naissance de l’opéra à la cour des Médicis, on attend, ce mois-ci, le DVD de L’Orfeo de Luigi Rossi, filmé à l’Opéra National de Lorraine, en 2016. Suivra, début 2018, un hommage à la « tragédie lyrique » française du XVIIIe siècle, avec Stéphane Degout en soliste. À la scène, rendez-vous dès le 25 septembre, à l’Opéra-Comique, pour Miranda, spectacle conçu et réalisé par la géniale Katie Mitchell, autour des œuvres vocales et instrumentales de Purcell.
Comment la musique et la voix sont-elles entrées dans votre vie ?
J’ai d’abord eu une expérience de musique vide. Lorsque j’étais à la maternelle, à Versailles, l’école dans laquelle je me trouvais proposait, pour les années suivantes, des classes à horaires aménagés. Des enseignants étaient chargés de dépister les enfants qui avaient de l’oreille, un certain sens du rythme et une appétence évidente pour la musique. En cours préparatoire, j’ai donc intégré une de ces classes et commencé à apprendre le violon. Mais le professeur avec lequel j’étudiais avait pour objectif de nous faire franchir des paliers techniques successifs, sans laisser de place à la moindre découverte sensitive. Autant dire que la musique glissait sur moi.
Un événement précis vous a-t-il guidé vers le parcours qui a été le vôtre ?
La rencontre avec Jean-François Frémont, maître de chapelle des Petits Chanteurs de Versailles, a été déterminante. Il a trouvé que j’avais une voix intéressante et a souhaité que je rejoigne son ensemble ; j’ai d’abord refusé, puis j’y suis allé avec des semelles de plomb. Et là, le déclic s’est produit, un véritable choc, corporel, sensitif, provoqué par l’expérience de la polyphonie. Une sensation qui m’a traversé l’esprit et le cœur, celle de faire de la musique ensemble, accrue par l’acoustique incroyable d’une église.
Sans doute ne vous attendiez-vous pas à une autre rencontre imprévue, celle de Johann Sebastian Bach ?
Elle s’est produite très tôt. J’avais 9 ans lorsque j’ai participé, en tant que choriste, à une Passion selon saint Jean (Johannes-Passion) ; j’ai éprouvé l’impression profonde d’exister et de palper des choses qui me dépassaient, d’entrer dans des espaces et des mondes inconnus, de ceux qui se créent quand on fait partie d’un ensemble. J’étais devenu dépendant… comme je le suis aujourd’hui de la cigarette ! Bach m’a permis d’ouvrir de nouvelles portes. La musique liturgique m’a appelé, et avec elle le piano, l’orgue, le clavecin. Au fil des années, j’ai commencé à accompagner des répétitions, des offices, j’ai fait moi-même des répétitions et j’ai enfin donné mon premier concert. J’ai découvert la musique du langage corporel, son effet sur le son, l’importance du visage, des jeux de physionomie, toutes choses liées avec évidence à la notion de groupe.
Vous aviez un registre de contre-ténor, une voix fort appréciée du public aujourd’hui. N’avez-vous jamais pensé à faire une carrière de soliste ?
J’en ai fait une, microscopique, qui m’a amplement suffi ! Je n’avais pas le don. Je suis allé naturellement vers le registre de contre-ténor ; quand on est maîtrisien, l’usage de la voix de tête est évident. De soprano enfant, je suis passé à alto à la mue, et très brièvement à baryton. Mais j’avais surtout envie d’aller voir ce qui se passait de l’autre côté du miroir. Je voulais me montrer digne d’être engagé par des ensembles qui pourraient m’apprendre quelque chose. Pour ce qui est de la matière du chœur, par exemple, mon passage dans Les Cris de Paris avec Geoffroy Jourdain a été marquant. Des rencontres avec Jordi Savall ou Gustav Leonhardt m’ont apporté énormément, même si elles ont été fugaces ; et aussi mes expériences en tant que continuiste. J’ai étudié à Paris : le chant au CRR de la rue de Madrid, et la théorie au CNSMD de la Villette. Pendant mes études, je travaillais en professionnel dans différents groupes. J’ai rencontré des amis qui allaient par hasard être là, lorsque j’ai formé Pygmalion – j’ai toujours pensé que ce hasard était prémédité.
En créant Pygmalion, souhaitiez-vous disposer d’un ensemble constitué d’un chœur et d’un orchestre ?
Avant tout, je voulais partager cette envie d’explorer les mondes inconnus dont je vous ai parlé et de les visiter à ma manière, avec des gens de mon âge, un entourage proche et confiant, en ayant une entière liberté dans les choix de répertoire. Se tourner vers Bach, à l’époque, n’était pas simple ; peu de Français se risquaient à le défendre, car c’était un domaine réservé aux membres du sérail néerlandais, belge et anglais. D’un côté, la filiation Gustav Leonhardt, Philippe Herreweghe, René Jacobs ; et, en face, John Eliot Gardiner.
Un défi que vous avez commencé à relever avec vos premiers enregistrements parus chez Alpha, les Messes brèves (Missae Breves), entre autres…
Sans doute notre rêve était-il le fruit d’une forme d’insouciance juvénile ; nous voulions oublier cette stature unique dans laquelle Bach avait été figé, cette posture de patriarche de la musique. Nous voulions l’aborder avec gratuité, et avec cette générosité qui enlève toute distance. À son époque, la conscience de son génie était infime ; il était respecté par ses pairs, considéré comme un savant, mais personne n’aurait dit qu’il était capable de toucher quelqu’un jusqu’au plus profond de son être, encore moins de bouleverser un enfant de 9 ans, comme cela s’était produit pour moi ! Nous voulions nous l’approprier à notre manière de jeunes Français.